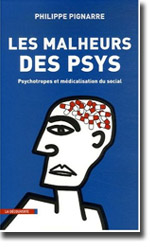|
Comment « solidifier
» le savoir psy ? Le rôle des associations de patients
Philippe Pignarre [1] |
Conférence prononcée le 12 octobre 2006 au colloque La
psychothérapie à l'épreuve de ses usagers.
|
|
|
On est souvent interpelé
dans toutes les réunions de « gauche », «
militantes » sur la question des associations de patients :
« Mais ce n’est pas une garantie ! ». Il existe
une grande méfiance à gauche envers ce qui est vécu
comme du « lobbying » opposé à la citoyenneté.
L’Afm (Association française contre les myopathies) et
le Téléthon sont souvent mis en cause : s’ils
se sont mêlés de la recherche ce serait en favorisant
certaines pathologies aux dépends d’autres et en misant
sur le tout génétique.
On verra que si l’on présente
les associations de patients comme une « garantie », on
passe à côté de ce que leur existence créée
justement comme potentialité politique nouvelle. Quand on est
dans le domaine de la politique, il n’y a justement pas de garanties.
Nous sommes aussi confrontés
à un autre problème : la plupart des médecins
sont convaincus que pour « rassurer les patients »,
ils doivent éliminer tout ce qui pourrait les amener à
douter, à se détourner d’un savoir qui ne se présenterait
pas comme suffisamment solide et qui revigorerait la menace permanente
du charlatan qui reste toujours là, tapi dans l’ombre.
On verra que la question de la définition de la maladie est
ici un enjeu. Reconnaître que l’on n’a pas de garantie
absolue dans la plupart des cas, non pas seulement de pouvoir guérir,
mais plus généralement de définir ce qu’est
une maladie est vécu comme insupportable et doit être
caché aux yeux du public.
C’est à cet endroit
précis que je voudrais donner du sens à la question
: pourquoi des associations de patients ?
Il s’agit de s’écarter
des réponses traditionnelles :
- Elles fourniraient une aide
« pédagogique » confirmant le rôle du corps
médical : consulter plus souvent, bien suivre son traitement.
Cette réponse est la plus obscène mais pas la moins
fréquente. De nombreuses associations dirigées par
des médecins (en particulier dans le domaine du cancer) fonctionnent
sur ce modèle.
- Il faudrait en accepter à
contrecœur l’existence mais elles ne feraient que traduire
la montée en puissance du consumérisme. On ne ferait
que reconnaître un rapport de forces qui oblige.
- Les reconnaitre serait une question
de « bonne volonté », une question morale comme
celle qui s’est imposée quand on a adopté l’idée
qu’il fallait dire la vérité aux patients.
Dans le domaine psy la question
des associations de patients prend une dimension presque tragique
: comment les techniques de soin basées sur le « tous
différents » peuvent-elles s’y confronter ? Y a-t-il
contradiction insurmontable entre la psychanalyse et les associations
de patients ?
Ce que nous allons essayer de montrer,
c’est que les associations de patients pourraient répondre
à une nécessité liée à ce que pourrait
être les conditions même de l’inventivité
dans ce domaine particulier caractérisé par sa grande
fragilité : la psy. Les associations de patients pourraient
être des lieux d’invention, d’apprentissages et
de consolidation de savoirs.
Il est vrai que les médecins sous influence psychanalytique
disposent d’une alternative : la « psychologie médicale
». Cette dernière donne la possibilité aux médecins
de croire qu’ils peuvent continuer à boucler seuls (avec
les biologistes) le cercle de la connaissance. Il s’agit alors
d’ajouter à une psychiatrie biologique (trop sèche),
une subjectivité mieux déployée. Il s’agit
par un saut vertigineux de rajouter une âme à une psychiatrie
qui serait déshumanisée du fait même de son trop
grand savoir technique.
Cette démarche est opposée
à la notre : ce que nous allons mettre en cause, c’est
l’existence même de la psychiatrie biologique comme savoir
bien constitué, solide. Nous ne cherchons pas à humaniser
des psychiatres dont le défaut serait d’être trop
techniciens, prenant trop un appui exclusif sur des savoirs scientifiques
éprouvés. Il n’y a rien à équilibrer
de cette manière car c’est bien la constitution même
de la psychiatrie comme savoir un peu plus stable qui est notre préoccupation.
Ce n’est pas d’âme dont manque la psychiatrie mais
de savoirs bien constitués.
|
télécharger au format word : 
|
 Collectif ou individuel : un faux dilemme
Collectif ou individuel : un faux dilemme
|
|
|
Je vais donc essayer de poser un problème sans reprendre ses
arguments qui sont en permanence recyclés comme dans un lave-linge
sur l’opposition entre une thérapeutique adaptée
à chaque cas individuel, artisanale, élaborée
dans le cadre de la rencontre patient-médecin et où
les patients auraient le privilège d’être des «
sujets » (vous aurez reconnu la psychanalyse) et une médecine
technicienne où les patients ne sont que des cas sans individualité.
Nous ne partons pas ici de rien.
L’ethnopsychiatrie a résolu ce problème en prenant
en charge les migrants : comment on dit et comment on fait «
chez toi » ? Les dispositifs techniques inventés par
Tobie Nathan et ses collègues sont organisés autour
de la nécessité de permettre l’émergence
et l’affirmation d’une expertise des patients en tant
qu’ils appartiennent à un collectif qui les définit
de manière incontournable. Il ne s’agit donc pas d’une
position « embusquée » qui consisterait à
écouter, certes poliment, ce que le patient ou un membre de
son entourage dit, pour le réinterpréter dans son dos
dans les termes de la métapsychologie psychanalytique. Cette
position serait non pas celle de l’ethnopsychiatrie mais plutôt
celle de la psychiatrie transculturelle représentée
en France par Marie-Rose Moro. Il faut prendre au sérieux ce
dont les patients et les membres de leur groupe témoignent.
Dans cette démarche, l’ethnopsychiatrie
se confronte à deux problèmes :
- La pluralité des mondes
- Les modes d’exploration de chaque monde.
Elle rejoint là un problème
qui a été posé par un courant philosophique qui
va de William James à Isabelle Stengers et Bruno Latour.
Cela n’empêche donc pas les patients d’être
tous différents et de ne pas recevoir un traitement standardisé…
Le « dilemme incontournable » de la psychanalyse est devenu
la raison d’être d’un renouveau de la psychothérapie,
avec la création de nouveaux dispositifs techniques. C’est
pour mieux comprendre et prendre en charge un individu unique dans
sa souffrance (pour parler comme les psys) que l’on doit faire
le détour par quelque chose, un savoir, qui est collectif.
Parce que ce quelque chose est un ensemble de ressources et en tant
que tel donne des moyens d’agir. Si on ne parle pas de dépression
dans une culture particulière, on ne se contentera pas de renvoyer
cela à une sorte d’infériorité culturelle
de patients qui doivent (tout comme leur entourage, les enseignants,
etc.) être éduqués (ce qui est un peu ce que proposent
les psychiatres transculturalistes américains comme Arthur
Kleinman, par exemple, dans le cas des Chinois). Il existe des versions
plus ou moins fortes de ce programme, certaines étant proches
d’un nouveau racialisme (quand on considère, par exemple,
que l’Anglais est la langue le « plus évoluée
» qui traduit le mieux les vrais sentiments).
A l’inverse, l’ethnopsychiatrie
ne renvoie jamais ce type de différences à quelque chose
qui relèverait seulement des phénomènes (des
symptômes), l’essentiel (la substance) restant inchangée.
Et cela pour une raison très pratique, pragmatique : cette
différence change les « voies d’entrée ».
Il faut bien reconnaître que la vieille théorie des symptômes
avec laquelle la médecine se décrit encore quelque fois
(quand elle fait de la vulgarisation) ne correspond pas à la
réalité de la pratique médicale. Pourquoi est-elle
conservée intacte en psy aussi bien par les psychanalystes
que par les « biologistes » ?
|
|
 Ce que les médicaments ont changé
Ce que les médicaments ont changé |
|
|
Je voudrais partir de la question de ce que font les médicaments
:
1- Avant d’agir sur les patients,
ils agissent sur les thérapeutes en agissant sur des échantillons
de patients. Comment ? Ils confortent des regroupements de patients,
voire les rendent possibles. Ils changent leur manière de
regarder.
Ils arment le regard médical ce qui est indispensable pour
faire des études cliniques (afin des savoir si ces médicaments
ont une efficacité quelconque), puis de « bien prescrire
».
Il faut se rappeler ici l’épisode de 1972 : on montre
à des psychiatres américains et anglais des enregistrements
vidéos de patients et on leur demande de poser un diagnostic.
Or, ils se trouvent que dans 80 % des cas ils ne font absolument
pas les mêmes diagnostics : les Américains voient des
schizophrènes là où les Anglais voient des
maniacodépressifs. La conclusion vient en 1980 : le DSM-III
ne prétend pas dire la vérité sur les troubles
mentaux, mais doit permettre de faire poser partout le même
diagnostic face au même patient.
Mais les médicaments ont été décevants
dans le sens où ils ne nous ont rien appris sur la potentielle
origine biologique d’un quelconque trouble mental même
si on a longtemps prétendu l’inverse quand on se gargarisait
par exemple avec l’hypothèse dopaminergique de la schizophrénie.
Aujourd’hui la dopamine se retrouve mise à toutes les
sauces y compris l’hyperactivité avec déficit
de l’attention. Les médicaments n’ont pas fait
avancer le projet de « psychiatrie biologique ». En
revanche, ils mettent en correspondance et consolident l’existence
d’une « petite biologie » (techniques utilisées
pour mettre au point de nouveaux psychotropes en utilisant les anciens
comme des « moules ») et d’une « petite
psychologie » (redéfinition des troubles mentaux et
psychologiques en fonction de l’action des médicaments
disponibles) qui puisent leur force dans leur double existence et
dans leur construction simultanée et continue, « machinique
». Les deux sont faibles, les deux ont besoin l’une
de l’autre pour conforter leur légitimité.
2- Ensuite, les psychotropes agissent
aussi sur les patients de plusieurs manières : à condition
que « ça marche » (même si c’est
seulement en partie, imparfaitement, de manière inégale,
transitoire, pour des raisons qu’on ignore, etc.).
Quelles conséquences en tirer ? Quelles connaissances avons-nous
?
A cet endroit, nous sommes bien obligés de constater la faiblesse
de nos connaissances sur ce que font les psychotropes. Cette faiblesse
entre en écho avec la crise du modèle de connaissance
basé sur les essais cliniques de courte durée qui
permettent d’obtenir une Autorisation de mise sur le marché
et qui est désormais patente dans tous les secteurs de la
thérapeutique. Quel est le rapport bénéfices/risques
des différents antidépresseurs, neuroleptiques ? Lesquels
prendre ? Y a-t-il surconsommation ?
Mais les psychotropes ont une autre action sur les patients. Les
classifications issues de l’invention des psychotropes sont
aussi la création de sortes de « lieux refuge »
pour les personnes qui ne vont pas bien, de « niches écologiques
». Ils ont tendance à rendre importants certains traits
et à rendre négligeables certaines autres caractéristiques
présentées par des patients. Ils font le tri dans
les manifestations qui sont importantes et celles qui ne le sont
pas. Ils dictent les questions que les prescripteurs poseront.
Les médicaments psychotropes favorisent la constitution de
« plus petits dénominateurs communs » en fonction
de ce sur quoi ils agissent (même imparfaitement). Ils sont
l’élément constitutif de nouveaux réseaux
proposant des modes d’être, des modes d’autodéfinition,
des modes d’identité aux personnes qui ne vont pas
bien.
Il n’y a pas que les médicaments qui savent faire ce
type de tri, même s’ils occupent de plus en plus de
place. L’épidémie des troubles des personnalités
multiples aux Etats-Unis est un exemple qui reste saisissant de
la possibilité de « niches écologiques ».
Il serait un peu court de n’y voir que des opérations
de suggestion induites par de mauvais thérapeutes comme il
serait un peu court de ne voir dans les pathologies comme la dépression
ou l’hyperactivité que l’effet de la propagande
des laboratoires pharmaceutiques.
Dans son très beau roman La Proie des âmes, Matt Ruff
imagine le dialogue suivant entre deux personnes souffrant de ce
trouble, à propos des êtres qui les peuplent :
« - Vous les avez convoqués pour qu’ils vous
aident à supporter des choses trop lourdes à gérer
toute seule. Et, pour la plupart, ils sont toujours là, toujours
prêts à voler à votre secours, mais maintenant
ils commencent à avoir leurs propres désirs, leurs
propres besoins, et ça complique les choses
- C’est complètement fou.
- Non. En, revanche vous auriez pu devenir folle, avec tout ce que
vous a fait subir votre mère. Mais vous n’en avez rien
fait. Plutôt vous avez inventé quelque chose. Et c’est
génial, seulement, maintenant, il va falloir être encore
plus inventive si vous voulez remettre un peu d’ordre dans
votre vie. »
J’aime ce livre car l’auteur n’oppose pas «
invention » et réalité de la maladie. C’était
une invention peut-être indispensable, mais d’autres
étaient sans doute possibles (elle aurait pu devenir «
folle » dit l’auteur avec humour comme si elle ne l’était
pas assez !). Au début du livre, le personnage souffre de
trous de mémoire gigantesques. Il se réveille sans
savoir ce qu’il a fait pendant quelques heures ou plusieurs
semaines. C’est après sa rencontre avec un thérapeute
que le mal dont il souffre se « stabilise » sous la
forme de personnalité multiple.
Les psychotropes sont aussi des inventions, dans un double sens
: ils modifient le fonctionnement du cerveau et ils créent
des diagnostics refuges. Mais ce n’est pas parce qu’une
substance peut être utile à un moment donné
de l’expérience d’une personne que celle-ci ne
tire que des avantages de la requalification de cette expérience
en une maladie définie par l’action du médicament.
Même si ces avantages existent au niveau mental (éloignement
des symptômes), moral (déculpabilisation, nouvelle
identité) et au niveau financier (prise en charge).
J’introduis peut-être ici une question un peu bizarre
: je pourrai donner l’impression que l’on peut finalement
« choisir » son trouble mental. Toute la psychiatrie
se construit contre cette idée même si elle la fait
resurgir en permanence (en reconnaissant qu’un diagnostic
peut en cacher un autre, qu’une intervention thérapeutique
peut faire apparaître un nouveau trouble, en employant des
formules comme celles de troubles « borderline », en
abandonnant la distinction névrose/psychose, en préconisant
un usage transnosologique des psychotropes). Il faut citer ici le
texte de l’écrivain William Styron dans lequel il raconte
sa dépression (Face aux ténèbres. Chronique
d’une folie, Gallimard/Follio) et qui vient en écho
à celui de Matt Ruff :
« Un phénomène que beaucoup de gens en proie
à une grave dépression ont pu constater, est la sensation
d’être en permanence escorté par un second moi
– un observateur fantomatique qui, ne partageant pas la démence
de son double, est capable d’observer avec une curiosité
objective tandis que son compagnon lutte pour empêcher le
désastre imminent, ou prend la décision de s’y
abandonner. Il y a là quelque chose de théâtral,
et pendant les quelques jours qui suivirent, tout en m’employant
avec flegme à préparer ma disparition, je ne parvins
pas à me défaire d’un sentiment de mélodrame
– un mélodrame dont moi, la victime potentielle d’une
mort volontaire, j’étais à la fois l’acteur
solitaire et l’unique spectateur. »
La dépression de William Styron sera soignée avec
des antidépresseurs (sans que l’on soit tout à
fait sûr qu’ils aient été efficaces) et
une hospitalisation. Mais cette phrase ne laisse-t-elle pas la possibilité
d’imaginer que d’autres devenirs étaient possibles,
en particulier, en fonction du thérapeute rencontré
?
Je vais essayer de montrer qu’il faut être prudent avec
cette question du choix mais que l’on peut avoir intérêt
à refuser les raisons pour lesquelles la psychiatrie la refuse.
La psychiatrie rêve d’une détermination absolue
des troubles mentaux et des troubles du comportement. C’est
ce qui explique son enthousiasme pour la génétique,
la biologie, l’imagerie cérébrale, qui sont
présentées comme porteur d’une promesse d’une
belle détermination. Une détermination, simple, compréhensible,
unique. Un gène : un trouble mental. Comme ça ne marche
pas, elle est amenée à multiplier les « déterminations
». On va mettre sous le nom d’environnement, tout ce
qui complique le problème mais permet de le penser dans les
termes de la détermination. Cela atteint un niveau absurde
dans les deux rapports Inserm de 2002 et 2005 consacrés aux
enfants et adolescents. On pourrait dire que cette notion d’environnement
telle qu’elle est employée dans les deux rapports est
anti-écologique : le milieu détermine les comportements
sans que soit pensée l’interaction. Le milieu est défini
de manière tellement vaste et imprécise que c’est
une notion qui rend impuissant. Par exemple, la manière dont
les comportements modifient eux aussi l’environnement, créent
un milieu qui sera favorable à leur développement
ou non, est totalement ignorée.
Avec les deux déterminations (le génétique
et l’environnement : des gènes défectueux, une
société cruelle) vous pouvez croire que vous pouvez
tout penser sans poser la question du choix, sans poser la question
de l’influence du thérapeute. Cela ferme aux patients
toute ligne de fuite hors de la médecine. Cela met les psy
en situation d’expertise universelle et incontestée.
Dire : il n’y a que des déterminations, c’est
retirer le patient du jeu et le transformer en spectateur de quelque
chose qui se joue ailleurs et dont le maître absolu est soit
le psychiatre biologiste expert de troubles finalement génétiques
(de droite), soit le psychiatre humaniste expert des problèmes
sociaux (de gauche).
On pourrait commencer à introduire la notion de choix d’une
manière très simple : quel type de thérapeute
on choisit d’aller voir. Un prescripteur ? Un psychothérapeute
? De quelle école ? Or la définition du trouble, la
définition du patient lui-même, de son devenir, vont
alors changer en fonction même de ce choix.
On pourrait dire, en reprenant le travail fait par Henri Grivois
sur la psychose que l’on peut admettre que l’on ne choisit
pas ce qu’il appelle « l’épisode initial
». Mais qu’au-delà de cet épisode les
devenirs sont multiples.
|
 |
 Les notions de « maladie » et de « médicalisation
»
Les notions de « maladie » et de « médicalisation
»
|
|
|
Le DSM-III introduit une grande différence par rapport à
la psychanalyse qui a fait l’objet de peu de commentaires
: il y a une différence entre être malade et ne pas
être malade, il n’y a pas de continuum. Il y a une différence
qualitative.
C’est évidemment une question difficile :
- le risque de l’idée de continuum
est de dissoudre la notion de maladie, dans une référence
globale à la théorie de l’évolution qui
fonctionne par erreurs/adaptations successives (on reconnaîtra
là une idée de Georges Canguilhem)… Ce qui est
normal et maladie dans un contexte ne l’est pas dans un autre
contexte. Je trouve ce point de vue trop abstrait et général.
Ce n’est pas une idée très pratique.
- accepter l’idée de maladie semble finalement préférable.
Mais à condition de s’interroger sur la manière
dont une « difficulté » est étiquetée
maladie. Il y a une « version publique » qui présente
les choses comme allant de soit, absolutiste. Or, quand on regarde
chaque domaine particulier, on constate le triomphe du relativisme
: hypertension, cholestérol, mais aussi cancer. Dans tous
ces cas la « maladie objectivable » passe par l’élaboration
de critères relevant de la décision consensuelle et
qui sont soumis à révision régulière
(on vote ! et il n’y a aucune raison de s’en moquer
ou de penser que c’est un pis-aller provisoire). Même
les examens de laboratoire qui permettent de poser le diagnostic
sans voir le patient ne constituent pas une « garantie ».
Il n’y a pas de « garantie »
absolue hors du passage par la discussion collective et l’établissement
consensuel de ce qu’est une maladie. C’est parfois facile
mais le plus souvent horriblement difficile. Il n’y a donc
pas un statut particulier qui distinguerait les troubles mentaux
de nombreux autres troubles somatiques sinon qu’ils se situent
à l’extrémité d’un spectre. La
possibilité d’examen de laboratoire dans le second
cas ne suffit pas mais ne fait que repousser le problème
(ils assurent seulement de manière plus solide que tous les
médecins feront le même diagnostic).
On pourrait distinguer trois régimes d’existence des
maladies, du plus stable au moins stable :
1- existence d’une anomalie
génétique ou biologique ou présence d’un
germe
2- dysfonctionnement biologique (un dérèglement physiologique)
mesurable par des examens de laboratoires avec des seuils déterminés
(et révisables) par consensus d’experts
3- diagnostic possible uniquement dans la rencontre médecin-patient,
de plus en plus régulé par la fixation de repères
d’observation par consensus d’experts.
Cette typologie ne se veut pas définitive et exhaustive.
Elle est construite en fonction de la place indépendante
prise par le savoir des biologistes dans la construction médicale
: ce qu’on pourrait appeler la solidité de ce savoir
biologique, sa capacité à refermer ce que les sociologues
des sciences ont appelé des « boîtes noires »
(plus personne ne conteste le rapport entre le virus HIV et le sida,
c’est une boîte noire refermée).
C’est aussi la notion de symptôme
qui est ici en jeu : il change de définition dans les trois
cas de cette typologie. La relation cause-symptôme, présentée
comme l’idéal d’une médecine qui doit
s’attaquer aux causes, ne correspond à la pratique
médicale que dans le premier cas. Il n’y a que dans
le premier cas que le symptôme est une manifestation de quelque
chose de connu et sur lequel nous pouvons, éventuellement,
intervenir (maladies infectieuses). Dans le deuxième et troisième
cas, ce qui s’appelle encore « symptôme »
n’est pas d’abord une manifestation, mais la possible
cause de nouveaux problèmes, une sorte de maillon intermédiaire
dans une cascade de causes et d’effets. Et dans le troisième
cas, la manière dont le thérapeute saisit, accueille
le symptôme, participe du devenir du patient, ce qu’ont
montré des auteurs aussi différents que Ian Hacking
ou Henri Grivois. On sent bien cette différence quand on
entend les experts vouloir continuer à parler de causes dans
les cas 2 et 3 alors qu’ils emploient les mots de «
polyfactoriels », d’environnement », ce dont je
viens juste de parler.
On aurait sans doute tout intérêt à rendre cette
typologie plus subtile. Un exemple comme celui de l’allergie
permettrait, par exemple, de bien compliquer les choses.
On pourrait presque dire que l’on emploie le mot de «
maladie » dans les trois cas là où il faudrait
trois mots différents. C’est bien ce qu’ont reconnu
les psychiatres quand ils ont décidé de ne plus parler
de maladies mentales, mais de troubles mentaux.
Mais pour en rester à cette classification élémentaire
qui a l’avantage de rester au plus près du travail
pratique des médecins, on pourrait dire des maladies de type
2 et 3 qu’elles imitent celles de type 1, comme si elles étaient
« en manque » ! La médecine scientifique
rêve de transformer toutes les maladies en maladies de type
1 qui serait le seul mode noble de stabilisation. La théorie
du symptôme n’est valable que dans le cas 1, dans les
autres cas on « fait « semblant » !
On peut aussi constater que plus on s’éloigne du type
1 et plus il faut savoir que les médicaments vont jouer un
rôle dans la stabilisation de la définition de la maladie,
faute de meilleur candidat. Car le médicament en améliorant
ou en guérissant, conforte la définition de la cible
sur laquelle il agit en tant que maladie.
Dans les trois cas, il faut donc beaucoup d’intermédiaires,
de travail en commun, de décisions, pour définir les
maladies. Et ce qui nous intéresse ici est la différence
existant entre ces intermédiaires. Cela ne s’impose
pas de soi.
C’est là où le discours de droite tente de dissimuler
la réalité de ces modes d’existence différents,
et où le discours de gauche dénonce : ce ne sont donc
« que » des constructions ? C’est donc de la manipulation
? C’est donc le libre pouvoir des industriels et des experts
corrompus qui règne ?
Nous ne sommes d’accord ni avec les uns ni avec les autres.
Oui, la définition de l’état de maladie suppose
de gigantesques et pénibles opérations de construction.
Non, cela ne permet pas toutes les manipulations.
Le débat continuité ou rupture n’est donc en
lui-même pas très intéressant car il ne correspond
pas à ce que les acteurs font pratiquement. Le problème,
c’est comment on établit, construit les outils techniques
qui permettent de créer et de toujours réinventer
la frontière entre maladie et normalité.
Le choix de la continuité entre état normal et maladie
donne le pouvoir au psychanalyste comme spécialiste «
des comportements humains en général ». Le choix
de la rupture entre normal et pathologique est indispensable au
processus de médicalisation. Il permet de conforter le pouvoir
médical et est cohérant avec le monopole de la prescription.
Mais en faisant croire que l’on peut rendre compte de manière
absolument déterministe des troubles et des maladies, il
ne laisse aucun choix aux patients individuellement ou en association.
Ils ne sont condamnés qu’à se soumettre au savoir
des maîtres et à en faire la pédagogie.
|
|

Augmenter le nombre d’acteurs du consensus |
|
|
Trouver ce dont le trouble mental « n’est que »
la manifestation, mange tout. On y consacre tout notre effort collectif,
tout notre temps, tous nos budgets (chercher la variation génétique
qui détermine un trouble mental). En attendant on ne fait pas
autre chose, on n’explore rien d’autre.
Et si on arrêtait de ne penser qu’à ça ?
(En fait il y a bien une instance en suspend au-dessus de nos têtes,
mais ce n’est pas de la biologie… c’est l’industrie
pharmaceutique.)
Cet idéal n’est en aucune manière atteint et,
en attendant, on se débrouille autrement (sans une machinerie
objectivante passant par des prélèvements envoyés
dans un laboratoire d’analyse) pour les diagnostics comme pour
les choix de traitement…C’est cette manière de
faire autrement qui est importante, bien plus que ce dont on est en
attente… et qui ne vient pas.
Je propose de trouver les moyens de poursuivre, substituant par exemple
une « pratique pharmacologique », empirique, tâtonnante,
à la soit disant « psychiatrie biologique ». On
a déjà parlé de la manière dont les psychiatres
travaillent pour mettre au point des outils évolutifs comme
le DSM : ils votent. J’ai déjà dit qu’il
n’y avait aucune raison de s’en moquer. Au contraire il
faut s’en féliciter et élargir cette « démocratie
», la rendre plus efficace, plus en prise avec les différents
acteurs, les différents enjeux.
La dynamique lancée par la fabrication d’outils permettant
de regrouper sous un même diagnostic des patients différents
échappe au contrôle de ses initiateurs dès que
les patients s’y reconnaissent. Or dès que les patients
savent qu’ils ne sont plus seuls, uniques, incomparables, la
possibilité de groupements volontaires commence.
J’ai parlé de la « machine » à inventer
des médicaments, de son aspect machinique avec la petite biologie
et la petite psychologie. Ce n’est machinique – donc difficile
à contrôler, à gérer – que parce
qu’il y a le pouvoir médical en surplomb. Il barre la
route à tout « empowerment » des différents
acteurs. On est déjà dans ce que des sociologues américains
ont appelé un « drug centred model » mais on n’en
a que les effets négatifs à cause du maintien en surplomb
du « medical centred model ».
|
|
 Conclusion : « désemboîter » les substances
et la médecine
Conclusion : « désemboîter » les substances
et la médecine
|
|
|
Les associations de patients sont une des possibilités les
plus intéressantes pour stabiliser le savoir sur les maladies,
leurs frontières, leurs définitions. Puisqu’il
n’y a pas un savoir biologique incontestable et en surplomb
qui permette de mettre tout le monde d’accord sans débats,
il faut en passer par un débat qui soit le plus large possible.
Même si les associations de patients ont besoin de la médecine
pour « se définir », pour se trouver une raison
d’exister, ce n’est là qu’un moment transitoire
dans leur existence, avant leur « empowerment ». A elles
d’apprendre à la remettre en cause, à discuter
de ses pouvoirs, à lui retirer certaines fonctions.
Les associations doivent être une source d’innovation,
d’expertise et non pas la courroie de transmission des «
habitudes » de la médecine.
Face à une psychiatrie qui ne voit son futur que dans la découverte
de déterminismes (soit au niveau du gène malade soit
au niveau de la société malade), on peut penser que
les associations de patients sont la dernière chance de la
psychiatrie. Des risques existent, car les appareils sont extrêmement
puissants alors que les associations sont souvent faibles, qu’elles
soient, par exemple, transformées en courroie de transmission
de l’industrie pharmaceutique. Ce serait une défaite
collective.
Mais il y a aussi la possibilité de réussites qui, même
locales, donneront envie d’être imités comme ce
fut le cas du rôle des associations de patients dans la lutte
contre le sida.
Evidemment, on pourrait me dire : « les associations de patients
sont la dernière chance de la psychiatrie ? Mais on nous avait
déjà fait ce genre de promesses qui se sont révélées
illusoires. On nous avait dit :
- la psychanalyse est la dernière
chance de la psychiatrie
- les médicaments sont la dernière chance de la psychiatrie
- la génétique est la dernière chance de la
psychiatrie. »
La différence, c’est
que les associations de patients n’ont pas la prétention
de témoigner d’un savoir stable, définitif, d’être
une garantie fermant la bouche à tous les autres. A l’inverse,
les associations de patients peuvent mettre en politique, en culture,
les témoignages venus de la médecine, de la psychologie,
et des sciences connexes, elles sont capables d’accueillir toutes
les propositions nouvelles sans en faire des deus ex machina. En ce
sens, elles sont dans le prolongement de ce qui a été
inventé par le mouvement ouvrier au XIXe siècle sous
le nom de mutualisme et dont la Sécurité sociale telle
qu’elle a pris forme au sortir de la Seconde Guerre mondiale
est une forme généralisée.
Les associations de patients ne sont pas une quatrième promesse
pour qu’enfin le débat cesse, c’est, au contraire,
la promesse du débat qu’il faut toujours recommencer.
|
|
|
|
|
|
| Notes
[1]. Historien, directeur des éditions
Les Empêcheurs de penser en rond, auteur de nombreux ouvrages,
dont le dernier : Les malheurs des psys.
|
|
| |
 Droits de diffusion et de reproduction réservés ©
2006— Centre Georges Devereux
Droits de diffusion et de reproduction réservés ©
2006— Centre Georges Devereux
|
 |