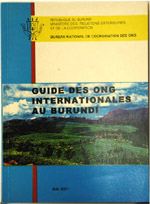|
LE « MARCHÉ » DU
TRAUMATISME: IMPORTATION DU PTSD AUPRÈS DE LA POPULATION BURUNDAISE
DES COLLINES
par Nathalie
Zajde |
|
Conférence prononcée le 12 octobre 2006 au colloque La
psychothérapie à l'épreuve de ses usagers. |
|
| QU’EST CE QUE LE PTSD ? |
|
| |
|
télécharger
au format word :


|
| Le tableau clinique [6]
du PTSD |
|
| |
— sentiments intenses de peur, de terreur
et d'abandon;
— reviviscences de l'événement traumatique;
— évitements de stimuli liés à l'événement;
— émoussement de la réactivité générale;
— hyperactivité neurovégétative;
— rêves traumatiques;
— souvenirs récurrents;
— périodes sensibles au moment des anniversaires;
— états dissociatifs;
— irritabilité particulière;
— perte de la capacité de concentration;
— labilité émotionnelle;
— sentiment que l'avenir est bouché;
— réduction de la capacité de modulation des
affects;
— peurs et soucis injustifiés et excessifs.
|
|
| LE BURUNDI |
|
| |
 Le
Burundi est un tout petit pays (environ 28 000 Km2) situé dans
une région montagneuse et enclavée, au centre de l’Afrique,
limitrophe du Rwanda, avec lequel il a longtemps constitué
un même royaume. Ils est aujourd’hui peuplé d’environ
6,5 millions d’habitants qui vivent dans des hameaux sur les
collines et qui sont essentiellement cultivateurs et bergers. La langue
nationale est le kirundi [7]. Le swahili
et le français sont les langues secondes, parlées par
la petite partie de la population qui vit en ville.
 C’est au début
du 19ème siècle, que des étrangers commencent
à connaître la région et à recueillir des
informations par écrit. C’est l’époque où
les caravanes des maîtres musulmans de la côte de Zanzibar
s’installent sur les bords du lac Tanganyika afin de ponctionner
les populations locales païennes destinées au commerce
des esclaves [8].
C’est probablement de cette époque que datent les premières
conversions à une religion monothéiste. Plus tard, vers
la fin du 19ème, la région est pénétrée
par les explorateurs blancs (venus d’Allemagne, d’Angleterre
et de France) à la recherche des sources du Nil, ainsi que
par les Pères Blancs et les missionnaires protestants (français
et hollandais) à la recherche d’âmes « sauvages
» à christianiser. Le Burundi (comme le Rwanda) sont
à l’époque des royaumes très structurés,
unifiés culturellement, religieusement, linguistiquement, politiquement
et gérés de manière centralisée. La société
burundaise est gouvernée par des rois et des clans et peuplée
de trois types d’habitants — les Twa, des Hutu et les
Tutsi [9] ; chaque groupe occupant
une place et une fonction complémentaires aux deux autres.
Les Hutu étaient traditionnellement agriculteurs, les Tutsi,
bergers, propriétaires de troupeaux de vaches et administrateurs,
alors que les Twa, maîtres de la forêt, étaient
chasseurs et potiers — sans doute aussi, comme souvent en pareil
cas, les guérisseurs les plus réputés. Une quatrième
catégorie, les Ganwa, assurait la direction du royaume; c’est
de ce tout petit groupe que provenaient les familles royales. Mais
les catégories n’étaient autrefois pas si étanches
qu’aujourd’hui. On pouvait devenir tutsi alors qu’on
était né hutu — en se mariant par exemple, ou
en achetant des vaches. Jusqu’à très récemment
encore, les mariages entre Hutu et Tutsi, étaient fréquents
— la règle de patrilinéarité étant
appliquée aux descendants de ces mariages « mixtes ».
 Le Burundi (comme
le Rwanda), d’abord sous domination allemande, fut confié
au royaume de Belgique par un mandat de la Société des
Nations après la première guerre mondiale — mandat
réactualisé par les Nations Unies sous forme de tutelle
après 1945 [10].
 Les Belges ont développé
le pays en y installant leurs institutions, leurs églises et
leurs prêtres. Le Burundi, ainsi que le Rwanda sont devenus
en très peu de temps des états extrêmement fervents.
La vie religieuse catholique continue à l’heure actuelle
d’occuper une place de premier ordre et les prêtres et
les Sœurs restent des personnages socialement très importants.
 Auparavant, les Burundais,
comme les Rwandais, respectaient des cultes païens, des cultes
aux ancêtres ( kubandwa) et aux
esprits des lieux ( baganza) [11].
Bien que toujours connus à l’heure actuelle, ces cultes
ont pratiquement entièrement cessé d’être
pratiqués sous la pression acharnée des Pères
Blancs et celle à présent des évangélistes
d’inspiration charismatique. Dès 1930, 70% de la population
était convertie au catholicisme [12].
 Depuis la décolonisation
et les indépendances (juillet 1962), le Burundi , comme le
Rwanda, sont le triste théâtre d’assassinats de
présidents, de coups d’état, et surtout de massacres
épisodiques dont les derniers ont pris la dimension de génocides
(1959, 1962, 1965, 1972, 1988, 1992, 1993, 1994) [13].
Les Nations Unies ont reconnu officiellement que le Rwanda avait été
le théâtre d’un génocide perpétré
par les Hutu contre les Tutsi durant l’année 1994 qui
fit entre 800 000 et 1 million de morts. La présence de soldats
étrangers (Nations Unies) n’a pas empêché
les massacres et certains dénoncent aujourd’hui non seulement
l’inertie des forces étrangères mais également
leur éventuelle participation à la préparation
du génocide [14].
La reconnaissance institutionnelle du génocide a été
suivie de la création par le Conseil de Sécurité
(résolution 955 de 1994) d’un tribunal pénal international
pour le Rwanda (TPIR), installé à Arusha en Tanzanie.
 Quant aux tueries
qui ont suivi l’assassinat du président burundais Melchior
Ndadayé en octobre 1993 [15],
et qui ont provoqué depuis la mort d’au moins 300.000
personnes, elles n’ont pour l’instant fait l’objet
d’aucun statut international reconnu et encore moins engendré
de procédures officielles ni de jugement. En outre, l’institution
juridique burundaise étant totalement exsangue, aucune procédure
n’est pour l’instant envisagée, aucun coupable
n’est identifié, aucune victime ne peut porter plainte.
De plus, des amnisties ont été régulièrement
proclamées par les différents chefs de gouvernements
afin de ne pas ajouter de motifs supplémentaires aux exactions
quotidiennes. Comme de nombreux pays d’Afrique, le Burundi est
depuis son indépendance gouverné par des hommes politiques
très liés à l’armée, quand ils n’en
sont pas directement issus. Le treillis militaire, la mitraillette
ou le fusil en bandoulière, font partie intégrante du
paysage. Au Burundi, depuis plus de dix ans, les gens se sont habitués
aux tirs de mortiers, aux rafales de mitraillettes et à l’instauration
régulière de périodes de couvre-feu. Les alentours
de Bujumbura habités jusqu’à très récemment
par les groupes rebelles les plus agressifs, ont fait de la capitale
une ville dangereusement accessible par la route jusqu’en 2004.
Durant cette période, ceux qui la prenaient tout de même
étaient obligés de verser leur dîme aux combattants
parfois même de renflouer au péril de leur vie, des voleurs
affamés.
 Les chercheurs s’entendent
pour reconnaître qu’il est fort difficile d’analyser
les conflits armés au Rwanda et au Burundi à partir
de la notion d’ « ethnie » [16].
Tous rappellent que Hutu, Tutsi et Twa parlent une même langue,
ont la ou les mêmes religions, revendiquent un même ancêtre
fondateur et vivaient, jusqu’à l’arrivée
des blancs, en relative harmonie — dans un équilibre
social à tout le moins stable. Autrement dit, la différence
de statut social et d’ «espèces » d’humains
– c’est le concept qu’utilise la langue kirundi
pour désigner Hutu, Tutsi et Twa, terme identique à
celui employé pour dire une « espèce » de
plante ou une « espèce » animale — n’impliquait
pas de comportement raciste ni violent jusqu’à la fin
des années 50. Le discours le plus répandu tant de la
part des intellectuels et des chercheurs belges et français
que des Rwandais et Burundais, accuse la présence coloniale
belge d’avoir insufflé une haine raciste entre les Hutu
et les Tutsi. Cette haine serait donc une conséquence des politiques
des gouverneurs belges qui pour mieux coloniser le pays agissaient
selon la logique du « diviser pour régner ». Ce
serait en privilégiant tour à tour les uns au détriment
des autres, en faisant jouer les privilèges, en manipulant
les Rwandais et les Burundais, que les Belges auraient fait naître
une détestation réciproque et meurtrière. Autrement
dit, l’une des manière les plus répandues d’envisager
la logique des problèmes graves des sociétés
rwandaises et burundaises contemporaines est historique, causale et
en quelque sorte étiologique et accusatrice. L’histoire
et les événements passés sont en quelque sorte
pris comme source explicatives, comme arguments pouvant rendre compte
des massacres. Selon cette logique, les deux sociétés
burundaise et rwandaise seraient essentiellement de tristes et maudits
produits des politiques de gouvernance de la tutelle belge.
 Notons tout de même
que certains chercheurs et intellectuels [17]
commencent à penser que si les guerres dans la région
n’étaient pas motivées par des différends
de nature ethnique, elles ont certainement contribué à
fabriquer une réalité « ethnique » qui semblait
jusqu’alors absente du paysage. En effet, aujourd’hui
les mariages entre Hutu et Tutsi sont devenus très rares, presque
impossibles, les quartiers ne sont plus mixtes, les églises
sont devenues « mono groupe »… Il semble donc plus
intéressant de rechercher ce qu’ont produit les conflits
et les tueries plutôt que de s’interroger sur ce qui les
a produits… Les guerres ne seraient-elles pas également
une réponse structurelle à la déstabilisation
imposée par la décolonisation ? Ne devrait-on pas considérer
ces guerres comme les sinistres conditions présidant à
l’émergence de groupes, de poches identitaires rendues
nécessaires par la désorganisation générale
? Si c’était le cas, le refus de reconnaissance de ces
distinctions identitaires en train de naître ne ferait que renforcer
la violence des conditions de leur apparition.
|
|
| QUELQUES ÉLÉMENTS PSYCHO-SOCIAUX
CONTEMPORAINS |
|
| |
 La
crise ouverte au Burundi a duré de 1993 à 2004.
 Malgré un
gouvernement de transition composé de 17 partis politiques,
malgré la présence de différents organismes internationaux
de maintien de la paix et d’aide humanitaire, les agressions
armées étaient quotidiennes, les conditions de vie extrêmement
difficiles et la peur se lisait sur la plupart des visages.
 C’est lors
d’un séjour de deux années, de 2003 à 2004,
que j’ai pu recueillir les données sur la situation psycho-sociale
du Burundi.
 En 2003, on recense
6000 enfants soldats et 660 000 orphelins dus à la guerre,
aux tueries, aux rapines, au Sida ou à la maladie [18]
dont une quantité impressionnante de jeunes enfants devenus
« chefs de famille » et d’autres devenus membres
ou chefs de bande de délinquants qui errent dans la capitale
et sèment la terreur.
 A cette période,
le Burundi, à l’encontre du Rwanda, est encore un pays
difficile d’accès et classé dangereux par les
Nations Unis (dont les employés sont contraints de laisser
conjoints et enfants dans un pays limitrophe par mesure de sécurité).
 En 2004, le Burundi
est classé pays le plus pauvre au monde. L’insécurité
due aux attaques régulières des bandes armées,
aux rapines par des individus ou des groupes affamés et aux
viols quotidiens des femmes et des jeunes gens, rend impossible la
culture des terres, la libre circulation des personnes, l’accumulation
de biens. On recenses plusieurs centaines de milliers de personnes
déplacées – vivant loin de chez elles, dans des
camps ou dans des habitations de fortune.
|
|
| LE SOIN DU TRAUMATISME |
|
| |
 Les dispositifs
de soin spécifiques aux populations psychiquement traumatisées
en raison des situations de meurtre de masse, de génocide
et d’insécurité sont soutenus essentiellement
par les organismes étrangers. Ces dispositifs sont peu nombreux
au regard des besoins immenses de la population. Les dispositifs
de soin spécifiques aux populations psychiquement traumatisées
en raison des situations de meurtre de masse, de génocide
et d’insécurité sont soutenus essentiellement
par les organismes étrangers. Ces dispositifs sont peu nombreux
au regard des besoins immenses de la population.
 La formation psychologique
des professionnels burundais est essentiellement psycho-dynamique,
largement inspirée des théories psychanalytiques des
enseignements francophones — français ou belges —
reçus dans les 1970, période où la psychanalyse
s’enseignait systématiquement dans les cursus de psychiatrie
et de psychologie clinique européens. Rappelons que l’université
du Burundi — jadis l’une des plus prisées de
la région — est elle aussi en crise depuis plus de
dix ans. Elle ne possède pratiquement pas d’ordinateurs,
pas d’Internet — tout au moins jusqu'en 2004 —,
pas de livres publiés après 1990, ne dispose pas de
moyens de protection des ouvrages vite abîmés par l’humidité,
la poussière et la lumière. Elle subit, comme toutes
les institutions du pays, les aléas liés aux difficultés
de paiement des salaires, aux coupures d’électricité
et à l’entretien défectueux. La plupart des
professeurs, dès qu’ils le peuvent, s’exilent
dans des pays où leur salaire est assuré de manière
décente et régulière, où leurs conditions
de vie et de travail sont normales — le Burundi souffre de
la malheureuse « fuite des cerveaux » propre pays en
guerre et pauvres. Seuls quelques fidèles, profondément
attachés à leur pays restent et luttent, quelles que
soient les conditions, pour le maintien d’un minimum de savoir
et de transmission au Burundi. C’est le cas du Docteur Sylvestre
Barancira, l’unique psychiatre du Burundi, formé en
France dans les années 1980 revenu vivre au pays et soigner
ses compatriotes. Il est donc le seul psychiatre des 6,5 millions
de Burundais. En outre, le Burundi ne dispose pas de spécialisation
à la psychiatrie dans sa faculté de médecine. La formation psychologique
des professionnels burundais est essentiellement psycho-dynamique,
largement inspirée des théories psychanalytiques des
enseignements francophones — français ou belges —
reçus dans les 1970, période où la psychanalyse
s’enseignait systématiquement dans les cursus de psychiatrie
et de psychologie clinique européens. Rappelons que l’université
du Burundi — jadis l’une des plus prisées de
la région — est elle aussi en crise depuis plus de
dix ans. Elle ne possède pratiquement pas d’ordinateurs,
pas d’Internet — tout au moins jusqu'en 2004 —,
pas de livres publiés après 1990, ne dispose pas de
moyens de protection des ouvrages vite abîmés par l’humidité,
la poussière et la lumière. Elle subit, comme toutes
les institutions du pays, les aléas liés aux difficultés
de paiement des salaires, aux coupures d’électricité
et à l’entretien défectueux. La plupart des
professeurs, dès qu’ils le peuvent, s’exilent
dans des pays où leur salaire est assuré de manière
décente et régulière, où leurs conditions
de vie et de travail sont normales — le Burundi souffre de
la malheureuse « fuite des cerveaux » propre pays en
guerre et pauvres. Seuls quelques fidèles, profondément
attachés à leur pays restent et luttent, quelles que
soient les conditions, pour le maintien d’un minimum de savoir
et de transmission au Burundi. C’est le cas du Docteur Sylvestre
Barancira, l’unique psychiatre du Burundi, formé en
France dans les années 1980 revenu vivre au pays et soigner
ses compatriotes. Il est donc le seul psychiatre des 6,5 millions
de Burundais. En outre, le Burundi ne dispose pas de spécialisation
à la psychiatrie dans sa faculté de médecine.
Les théories « psy »
 Les théories
utilisées par les nouveaux formateurs non universitaires,
souvent mandatés par des ONG protestantes américaines,
consistent en un savant mélange de théorie du sujet,
de théorie du renforcement du moi, théorie de l’affect
et de sa libre expression, mêlées à la nomenclature
du Manuel Diagnostique Statistique des troubles mentaux (DSM). À
cet ensemble, il faut ajouter des propositions directement inspirées
des croyances et pratiques des églises charismatiques protestantes
et évangélistes, telles que l’encouragement
au partage des émotions, l’incitation à la parole
publique, l’exhortation au pardon. Les théories
utilisées par les nouveaux formateurs non universitaires,
souvent mandatés par des ONG protestantes américaines,
consistent en un savant mélange de théorie du sujet,
de théorie du renforcement du moi, théorie de l’affect
et de sa libre expression, mêlées à la nomenclature
du Manuel Diagnostique Statistique des troubles mentaux (DSM). À
cet ensemble, il faut ajouter des propositions directement inspirées
des croyances et pratiques des églises charismatiques protestantes
et évangélistes, telles que l’encouragement
au partage des émotions, l’incitation à la parole
publique, l’exhortation au pardon.
 Les psychotropes
sont rares (trop chers) et souvent d’ancienne génération. Les psychotropes
sont rares (trop chers) et souvent d’ancienne génération.
 Comme dans bon
nombre de pays d’Afrique, ici, la plupart des dispositifs
psychologiques et psychothérapiques dépend directement
d’institutions religieuses (chrétiennes) ou laïques
étrangères (essentiellement des organismes non gouvernementaux)
implantées dans la Région. C’est grâce
à ces organismes que les psychologues burundais reçoivent
une formation supplémentaire à la psychothérapie. Comme dans bon
nombre de pays d’Afrique, ici, la plupart des dispositifs
psychologiques et psychothérapiques dépend directement
d’institutions religieuses (chrétiennes) ou laïques
étrangères (essentiellement des organismes non gouvernementaux)
implantées dans la Région. C’est grâce
à ces organismes que les psychologues burundais reçoivent
une formation supplémentaire à la psychothérapie.
Le Frère Michael Lapsley SSM
 L’un des
formateurs est un pasteur blanc, néo zélandais vivant
en Afrique du Sud [19], auquel
il manque les deux avant bras (remplacés par des tiges et
des crochets en métal). Cet homme sillonne l’Afrique
et l’Amérique en relatant son histoire : avant le changement
de régime en Afrique du Sud, alors qu’il était
connu pour ses positions anti-apartheid, un matin sans se méfier,
il a ouvert un paquet piégé que le postier venait
de lui déposer. Lors des conférences qu’il donne
dans des salles combles, il montre ses crochets et explique qu’il
pardonne à son agresseur, qu’il croit en l’humanité,
qu’il a confiance dans la force et la bonté qui existent
en chacun des hommes. Il dit même que si d’aventure
il rencontrait celui qui lui a envoyé la bombe qui a si radicalement
changé le cours de sa vie, il ne le blâmerait pas,
mais lui proposerait de travailler pour lui, de l’aider à
accomplir toutes sortes de tâches qui, depuis cet attentat,
lui sont devenues difficiles ou impossibles. Ce pasteur a créé
un dispositif psychothérapique qu’il a appelé
« Guérison des mémoires » (« Healing
of Memories »), qui a été retenu par l’ONG
Search For Common Ground. L’un des
formateurs est un pasteur blanc, néo zélandais vivant
en Afrique du Sud [19], auquel
il manque les deux avant bras (remplacés par des tiges et
des crochets en métal). Cet homme sillonne l’Afrique
et l’Amérique en relatant son histoire : avant le changement
de régime en Afrique du Sud, alors qu’il était
connu pour ses positions anti-apartheid, un matin sans se méfier,
il a ouvert un paquet piégé que le postier venait
de lui déposer. Lors des conférences qu’il donne
dans des salles combles, il montre ses crochets et explique qu’il
pardonne à son agresseur, qu’il croit en l’humanité,
qu’il a confiance dans la force et la bonté qui existent
en chacun des hommes. Il dit même que si d’aventure
il rencontrait celui qui lui a envoyé la bombe qui a si radicalement
changé le cours de sa vie, il ne le blâmerait pas,
mais lui proposerait de travailler pour lui, de l’aider à
accomplir toutes sortes de tâches qui, depuis cet attentat,
lui sont devenues difficiles ou impossibles. Ce pasteur a créé
un dispositif psychothérapique qu’il a appelé
« Guérison des mémoires » (« Healing
of Memories »), qui a été retenu par l’ONG
Search For Common Ground.
Search For Commom Ground
 Search For Common
Ground est un organisme américain qui dépend de l’ONG
américaine USAID. Search For Common Ground est largement
implantée en Afrique et en particulier au Burundi depuis
de longues années. Dans un programme appelé Integrated
Victims Of Torture program (IVOT), SFCG vient en aide aux victimes
de torture et de maltraitance, tant psychologiquement que juridiquement.
Dans ce cadre, elle informe et forme la population burundaise sur
la définition de la torture et son statut, votés par
les Nations Unies en 1984, ainsi que sur les conséquences
psychologiques et psychopathologiques des actions traumatiques. Search For Common
Ground est un organisme américain qui dépend de l’ONG
américaine USAID. Search For Common Ground est largement
implantée en Afrique et en particulier au Burundi depuis
de longues années. Dans un programme appelé Integrated
Victims Of Torture program (IVOT), SFCG vient en aide aux victimes
de torture et de maltraitance, tant psychologiquement que juridiquement.
Dans ce cadre, elle informe et forme la population burundaise sur
la définition de la torture et son statut, votés par
les Nations Unies en 1984, ainsi que sur les conséquences
psychologiques et psychopathologiques des actions traumatiques.
 Le programme de
sensibilisation est destiné au plus grand nombre, et s’attache
à former des formateurs, qui eux mêmes informent les
populations des collines sur la définition de la torture.
Il s’agit donc d’un systême en cascade, ou en
pyramide, visant à atteindre la majeure partie de la population
burundaise. Les personnes intervenant au premier niveau sont généralement
étrangères – américaines, africaines,
européennes. Elles informent des Burundais auxquels est confiée
la tâche de former à leur tour, qui eux mêmes
informent les burundais des collines. Le programme de
sensibilisation est destiné au plus grand nombre, et s’attache
à former des formateurs, qui eux mêmes informent les
populations des collines sur la définition de la torture.
Il s’agit donc d’un systême en cascade, ou en
pyramide, visant à atteindre la majeure partie de la population
burundaise. Les personnes intervenant au premier niveau sont généralement
étrangères – américaines, africaines,
européennes. Elles informent des Burundais auxquels est confiée
la tâche de former à leur tour, qui eux mêmes
informent les burundais des collines.
Définition retenue par les nations Unies
à New York en 1984[20].
 Première
partie, Article premier Première
partie, Article premier
1. Aux fins de la présente Convention, le terme "torture"
désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées
à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une
tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un
acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée
d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou
d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour
tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle
qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances
sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute
autre personne agissant à titre officiel ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce
terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances
résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes
à ces sanctions ou occasionnées par elles. [21]
 Les Burundais victimes
de torture et de viol selon cette définition, sont encouragés
à dénoncer leurs agresseurs et à les poursuivre
en justice. Cette formation à l’échelle d’un
pays entier soulève un certain nombre de questions tant d’ordre
socio éthique que pratique : il s’agit là d’importer
à l’aide de certains moyens financiers des options
ontologiques et des modalités de gestion des désordres
intimes autant que sociaux radicalement étrangères
à la société burundaise. L’importation
de ces théories et de ces concepts ayant trait au malheur
et à la maladie se fait comme si la société
burundaise n’était pas porteuse de ses propres valeurs,
de ses propres théories explicatives et de ses propres techniques
thérapeutiques. Certes, face à l’immensité
de la crise, la société proprement burundaise ne parvient
d’évidence pas à résoudre les conflits
et à guérir les plaies, mais on est en droit de questionner
l’efficacité et surtout les implications sociales de
l’imposition d’un système étranger qui
efface totalement les attachements, les « choses » et
les « objets » [22]
du peuple burundais. Pour l’heure, observons les modalités
d’introduction de tels concepts par les ONG et la manière
dont ils sont accueillis par la société burundaise. Les Burundais victimes
de torture et de viol selon cette définition, sont encouragés
à dénoncer leurs agresseurs et à les poursuivre
en justice. Cette formation à l’échelle d’un
pays entier soulève un certain nombre de questions tant d’ordre
socio éthique que pratique : il s’agit là d’importer
à l’aide de certains moyens financiers des options
ontologiques et des modalités de gestion des désordres
intimes autant que sociaux radicalement étrangères
à la société burundaise. L’importation
de ces théories et de ces concepts ayant trait au malheur
et à la maladie se fait comme si la société
burundaise n’était pas porteuse de ses propres valeurs,
de ses propres théories explicatives et de ses propres techniques
thérapeutiques. Certes, face à l’immensité
de la crise, la société proprement burundaise ne parvient
d’évidence pas à résoudre les conflits
et à guérir les plaies, mais on est en droit de questionner
l’efficacité et surtout les implications sociales de
l’imposition d’un système étranger qui
efface totalement les attachements, les « choses » et
les « objets » [22]
du peuple burundais. Pour l’heure, observons les modalités
d’introduction de tels concepts par les ONG et la manière
dont ils sont accueillis par la société burundaise.
 Le système
juridique burundais fonctionne fort mal — les juges sont trop
peu payés et préfèrent souvent travailler pour
le compte d’organismes étrangers à d’autres
fonctions nettement mieux rémunérées et moins
risquées (chauffeur ou même homme de ménage)
; les gardiens de prisons, dans certaines collines, en manque de
finance, exigent de la victime qui a porté plainte qu’elle
nourrisse chaque jour l’agresseur qu’elle a fait arrêter.
Il va sans dire que, dans un tel contexte, les violeurs ne sont
pratiquement jamais arrêtés. Le système
juridique burundais fonctionne fort mal — les juges sont trop
peu payés et préfèrent souvent travailler pour
le compte d’organismes étrangers à d’autres
fonctions nettement mieux rémunérées et moins
risquées (chauffeur ou même homme de ménage)
; les gardiens de prisons, dans certaines collines, en manque de
finance, exigent de la victime qui a porté plainte qu’elle
nourrisse chaque jour l’agresseur qu’elle a fait arrêter.
Il va sans dire que, dans un tel contexte, les violeurs ne sont
pratiquement jamais arrêtés.
|
|
Exemple d’un dispositif de guérison
« La guérison des mémoires » [23] |
|
|
| |
 La séance
de "thérapie" dure une journée entière,
dans les locaux de Search for Common Ground,
du centre ville de Bujumbura. L’animation est assurée
par une jeune psychologue burundaise. Cette séance réunit
une vingtaine de « victimes de torture » — enfants
et adultes, hommes et femmes — tous pauvres, certains mutilés
auxquels il manque bras, jambe, oreille, œil, etc. — qu’un
mini bus affrété par l’ONG est allé chercher
dans les collines qui surplombent Bujumbura. Les participants sont
assis en cercle, sur des chaises en matière plastique blanche,
et sont très attentifs au discours de la psychologue. Chacun
porte son prénom écrit sur un morceau de sparadrap collé
sur sa chemise (Evariste, Jean-Claude, Pierre Claver, Gervais, Gloriose,
Revocate, Germaine etc.). La psychologue explique en Kirundi la définition
de la torture retenue par les Nations Unies, les différents
types de torture, ainsi que les conséquences psychosociales
pouvant en découler. Afin d’être bien comprise,
l’animatrice dispose d’un tableau sur lequel elle inscrit
les différents termes spécialisés qu’elle
utilise – notamment ceux de l’État de stress post
traumatique du D.S.M. traduits en Kirundi [24]. La séance
de "thérapie" dure une journée entière,
dans les locaux de Search for Common Ground,
du centre ville de Bujumbura. L’animation est assurée
par une jeune psychologue burundaise. Cette séance réunit
une vingtaine de « victimes de torture » — enfants
et adultes, hommes et femmes — tous pauvres, certains mutilés
auxquels il manque bras, jambe, oreille, œil, etc. — qu’un
mini bus affrété par l’ONG est allé chercher
dans les collines qui surplombent Bujumbura. Les participants sont
assis en cercle, sur des chaises en matière plastique blanche,
et sont très attentifs au discours de la psychologue. Chacun
porte son prénom écrit sur un morceau de sparadrap collé
sur sa chemise (Evariste, Jean-Claude, Pierre Claver, Gervais, Gloriose,
Revocate, Germaine etc.). La psychologue explique en Kirundi la définition
de la torture retenue par les Nations Unies, les différents
types de torture, ainsi que les conséquences psychosociales
pouvant en découler. Afin d’être bien comprise,
l’animatrice dispose d’un tableau sur lequel elle inscrit
les différents termes spécialisés qu’elle
utilise – notamment ceux de l’État de stress post
traumatique du D.S.M. traduits en Kirundi [24].
 Sur un pan du mur
sont accrochés des posters dans un style naïf africain,
assez réalistes, montrant des individus soumis à différents
types de torture ayant court dans la région : un homme se tient
à genoux les mains ligotées dans le dos, un autre est
battu à l’aide d’un gourdin, un autre encore tel
un animal rapporté de la chasse, est suspendu à un tronc
d’arbre, par les chevilles et les poignets. Un petit documentaire
d’une durée de 5 minutes environ — montrant la
vie quotidienne d’une toute jeune adolescente ayant eu les mains
coupées lors de massacres en Sierra Leone, et tâchant
de survivre avec son handicap — est projeté afin d’expliciter
ce qu’on attend des participants: qu’ils témoignent
en public et sans pudeur des sévices subis, qu’ils dénoncent
les auteurs, qu’ils rendent compte des graves conséquences
médicales et sociales de la torture dans leur vie personnelle,
qu’ils expriment en toute liberté leurs émotions
et leur indignation, qu’ils disent ce dont ils ont à
présent besoin : aide psychologique, aide médicale et
ou aide juridique — les trois types d’aide que proposent
l’ONG. Chacun son tour, vivement encouragé par la psychologue
à combattre sa timidité ou sa pudeur, se lève,
se place devant l’assemblée, et expose, durant quelques
minutes, avec plus ou moins de gène, son expérience
de torture en montrant les parties de son corps mutilées. L’animatrice
attire l’attention des participants sur la similitude de leurs
souffrances, en les incitant, de ce fait, à mettre en commun
par la parole les expériences des traumatismes vécus
. Sur un pan du mur
sont accrochés des posters dans un style naïf africain,
assez réalistes, montrant des individus soumis à différents
types de torture ayant court dans la région : un homme se tient
à genoux les mains ligotées dans le dos, un autre est
battu à l’aide d’un gourdin, un autre encore tel
un animal rapporté de la chasse, est suspendu à un tronc
d’arbre, par les chevilles et les poignets. Un petit documentaire
d’une durée de 5 minutes environ — montrant la
vie quotidienne d’une toute jeune adolescente ayant eu les mains
coupées lors de massacres en Sierra Leone, et tâchant
de survivre avec son handicap — est projeté afin d’expliciter
ce qu’on attend des participants: qu’ils témoignent
en public et sans pudeur des sévices subis, qu’ils dénoncent
les auteurs, qu’ils rendent compte des graves conséquences
médicales et sociales de la torture dans leur vie personnelle,
qu’ils expriment en toute liberté leurs émotions
et leur indignation, qu’ils disent ce dont ils ont à
présent besoin : aide psychologique, aide médicale et
ou aide juridique — les trois types d’aide que proposent
l’ONG. Chacun son tour, vivement encouragé par la psychologue
à combattre sa timidité ou sa pudeur, se lève,
se place devant l’assemblée, et expose, durant quelques
minutes, avec plus ou moins de gène, son expérience
de torture en montrant les parties de son corps mutilées. L’animatrice
attire l’attention des participants sur la similitude de leurs
souffrances, en les incitant, de ce fait, à mettre en commun
par la parole les expériences des traumatismes vécus
.
 Cette réunion
dure une journée entière, avec une interruption à
midi au cours de laquelle sont offerts aux participants un déjeuner
et un "fanta". En fin de journée, la psychologue
distribue à chacun un morceau de papier sur lequel les participants
sont invités à écrire le ou les termes inscrits
au tableau désignant les séquelles ou les problèmes
dont ils souhaiteraient se débarrasser. Quand ils ne savent
pas écrire, c’est elle-même qui le fait pour eux.
Quand ils proposent une souffrance ou une plainte qui n’existe
pas dans le tableau clinique, elle leur demande d’en trouver
une autre [25]. Une fois que tous
ont inscrit leur mal sur le bout de papier, ils se lèvent,
déchirent en tout petits morceaux le bout de papier qu’ils
jettent à terre, tout en entonnant une chanson lancée
par l’animatrice « Gira Amahoro Mu Mutima » (Que
tu aies la paix dans le cœur ! Que tu aies la paix dans le cœur
! ). Chacun prend la main du voisin, de manière à former
un grand cercle et chanter avec plus d’entrain. La réunion
se clôture après que la psychologue ait pris soin de
fixer à chacun des participants un rendez-vous en fonction
de ses besoins correspondant aux services offerts par le programme
de l’ONG - La Guérison des mémoires étant
également un dispositif de recensement et d’orientation
des cas de torture existant dans le pays. Cette réunion
dure une journée entière, avec une interruption à
midi au cours de laquelle sont offerts aux participants un déjeuner
et un "fanta". En fin de journée, la psychologue
distribue à chacun un morceau de papier sur lequel les participants
sont invités à écrire le ou les termes inscrits
au tableau désignant les séquelles ou les problèmes
dont ils souhaiteraient se débarrasser. Quand ils ne savent
pas écrire, c’est elle-même qui le fait pour eux.
Quand ils proposent une souffrance ou une plainte qui n’existe
pas dans le tableau clinique, elle leur demande d’en trouver
une autre [25]. Une fois que tous
ont inscrit leur mal sur le bout de papier, ils se lèvent,
déchirent en tout petits morceaux le bout de papier qu’ils
jettent à terre, tout en entonnant une chanson lancée
par l’animatrice « Gira Amahoro Mu Mutima » (Que
tu aies la paix dans le cœur ! Que tu aies la paix dans le cœur
! ). Chacun prend la main du voisin, de manière à former
un grand cercle et chanter avec plus d’entrain. La réunion
se clôture après que la psychologue ait pris soin de
fixer à chacun des participants un rendez-vous en fonction
de ses besoins correspondant aux services offerts par le programme
de l’ONG - La Guérison des mémoires étant
également un dispositif de recensement et d’orientation
des cas de torture existant dans le pays.
|
|
| CONCLUSION |
|
| |
 Dans
un contexte de crise générale et meurtrière
où l’on a souvent l’impression que le Burundi,
petit pays enclavé, difficile d’accès et détruit,
est abandonné du reste du monde et n’intéresse
plus personne, la présence des ONG avec leur importation
de concepts psycho-sociaux typiquement occidentaux peut laisser
espérer aux Burundais qu’ils appartiennent encore à
la communauté des nations. Dans
un contexte de crise générale et meurtrière
où l’on a souvent l’impression que le Burundi,
petit pays enclavé, difficile d’accès et détruit,
est abandonné du reste du monde et n’intéresse
plus personne, la présence des ONG avec leur importation
de concepts psycho-sociaux typiquement occidentaux peut laisser
espérer aux Burundais qu’ils appartiennent encore à
la communauté des nations.
 Mais au vu du succès
des églises charismatiques et de leur capacité à
fédérer des opposants politiques, à rassembler
des foules immenses, à récolter des fonds provenant
de populations autrement en demande, à soigner et venir en
aide, enfin, à donner au Burundi une place dans la carte
mondiale des pays attirés par les nouveaux mouvements religieux,
il semble que les ONG soient sur le point d’être largement
surpassées. Mais au vu du succès
des églises charismatiques et de leur capacité à
fédérer des opposants politiques, à rassembler
des foules immenses, à récolter des fonds provenant
de populations autrement en demande, à soigner et venir en
aide, enfin, à donner au Burundi une place dans la carte
mondiale des pays attirés par les nouveaux mouvements religieux,
il semble que les ONG soient sur le point d’être largement
surpassées.
 Search For Commun
Ground comme l’ensemble des ONG qui s’inspirent des
théories psychologiques pour venir en aide aux populations
burundaises des collines traumatisées et terriblement appauvries
se trouve en réalité en directe concurrence avec les
églises charismatiques occupant aujourd’hui au Burundi,
un espace social et thérapeutique majeur. En effet, la grande
majorité des Burundais, des plus pauvres aux plus nantis,
appartient à une église, qu’elle soit charismatique
ou catholique et romaine. « Appartenir » signifie participer
financièrement et socialement à la vie de l’église.
Bon nombre de Burundais se font soigner dans ces églises,
qui proposent, plusieurs fois par semaine, des séances de
prière, de guérison, de transe et même, lorsqu’un
prêtre étranger célèbre est de passage,
des séances où l’on prétend "ressusciter
les morts". L’expertise du projet IVOT de Search for
Common Ground, a montré que les thérapeutes, embauchés
et formés par l’ONG pour soigner les victimes de torture
utilisent en réalité, non pas des techniques psychothérapiques,
mais les procédés enseignés dans leur église:
imposition des mains, prières, psaumes. Search For Commun
Ground comme l’ensemble des ONG qui s’inspirent des
théories psychologiques pour venir en aide aux populations
burundaises des collines traumatisées et terriblement appauvries
se trouve en réalité en directe concurrence avec les
églises charismatiques occupant aujourd’hui au Burundi,
un espace social et thérapeutique majeur. En effet, la grande
majorité des Burundais, des plus pauvres aux plus nantis,
appartient à une église, qu’elle soit charismatique
ou catholique et romaine. « Appartenir » signifie participer
financièrement et socialement à la vie de l’église.
Bon nombre de Burundais se font soigner dans ces églises,
qui proposent, plusieurs fois par semaine, des séances de
prière, de guérison, de transe et même, lorsqu’un
prêtre étranger célèbre est de passage,
des séances où l’on prétend "ressusciter
les morts". L’expertise du projet IVOT de Search for
Common Ground, a montré que les thérapeutes, embauchés
et formés par l’ONG pour soigner les victimes de torture
utilisent en réalité, non pas des techniques psychothérapiques,
mais les procédés enseignés dans leur église:
imposition des mains, prières, psaumes.
|
|
| BIBLIOGRAPHIE |
|
| |
 American
Psychiatric Association,1995, DSM-IV. Manuel diagnostique des troubles
mentaux, trad. fr. : Paris Milan Barcelone, Masson, 1996.
 Amselle J.L. &
M’Bokolo É. Éds. 1999, Au cœur de l’ethnie,
Paris, La Découverte.
 Barancira S. à
paraître, « À propos de l’épidémie
d’hystero-conversion collective chez les populations déplacées
au site de Gikomero en commune Rango, Province kayanza au Burundi.
» in Zajde N. Éd. coll. Rwanda & Burundi en sortie
de crise. L’état des lieux psycho-social.
 Barancira S. À
paraître : « la rumeur, la frayeur et les traumatismes
en situation de crise au Burundi. » in Zajde N. Éd. Rwanda
& Burundi en sortie de crise. L’état des lieux psycho-social.
 Birabuza A. 1998,
Le mal burundais ou l’involution d’une vieille nation,
Bujumbura, Burundi, Éditions de la renaissance.
Breackman C. 1994, Rwanda. Histoire d’un génocide, Paris,
Fayard, 1994
 Collart R. 1981, Les
débuts de l’évangélisation au Burundi,
Bologna, Italie, Éditions EMI.
 Chrétien J.P.
1997, Le défi de l’ethnisme, Paris, Kartalha.
 Chrétien J.P.
2000, L’Afrique des grands lacs, Paris, Éditions Flammarion,
2001.
 Eitinger L. 1961 "Pathology
of the concentration camp syndrome". Arch. Gen. Psychiat., R:371.
 Gahama J. 1983, Le
Burundi sous administration belge, Éditions C.R.A., Karthala
et A.C.C.T.
 Guichaoua A. 1997,
« Zoom sur …Les crises de la région des Grands
Lacs », Politique Africaine, n°68 , pp.11-22, Paris, Éditions
Karthala.
 Harroy J.P. 1984,
Rwanda. De la féodalité à la démocratie,
1955-1962, Bruxelles, Hayez.
 Hounkpatin L. 2005,
« Survivre au génocide …et après ? »
reevue Française de Psychosomatique, 28, 99-113.
 La Pradelle G. (de)
2005, Imprescriptible, L’implication française dans le
génocide tutsi portée devant les tribunaux, Paris, Éditions
les Arènes.
 Linden I. 1999, Christianisme
et pouvoir au Rwanda, Paris, Éditions Karthala.
 Mworoho É.
1987, (sous la direction de) Histoire du Burundi, des origines à
la fin du XIXème siècle, Paris, Éditions Hatier.
 Tobie Nathan, 2001,
Nous ne sommes pas seuls au monde, Paris, Les empécheurs de
penser en rond, Seuil.
 Niederland, W. C.
1964. Psychiatric disorders among persecution victims: A contribution
to the understanding of concentration camp pathology and its after-effects.
Journal of Nervous and Mental Diseases, 1964, 139, 458-474.
 Poulain G. 1998, Chasse
à l’homme au Burundi, Journal d’un expatrié,
octobre 1993, L’harmattan.
Renault & Daget 1985, Les traites négrières en Afrique,
Paris, Éditions karthala.
 Young A. 1995, The
Harmony of Illusions, Inventing Post Traumatic Stress Disorder, Princeton
University Press, Princeton, New Jersey
 Zajde N. 1998. «
Le Traumatisme » in Tobie Nathan & Coll. Psychothérapies.
Paris, Ed. Odile Jacob.Pp 223-279.
Zajde N. 2005, Guérir de la Shoah, Paris, Odile Jacob. |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Notes
[1]. American Psychiatric
Association.
[2]. Cf. sur la création du PTSD
et les Vétérans de la guerre du vietman, cf. Allan Young
1995.
[3]. Eitinger 1961. Niederland, 1964.
[4]. Pour une présentation critique
du syndrome du survivant, cf. Zajde 2005.
[5]. Sur le traumatisme psychique comme
unique pathologie psychiatrique causé par un évenement
social et necessitant une prise en charge « sociale » ou
psychologique, cf. Zajde 1998.
[6]. Notons que dans la version originale,
en anglais, les termes sont souvent plus courts et plus précis
: « Intrusive thoughts; distress at reminders; flashbacks; nightmares;
avoidance of thoughts; avoidance of situations; psychogenic amnesia;
diminished interest; emotional detachment; restricted range of affect;
sense of foreshortened future; difficulties with sleep; irritability;
impaired concentration; hyper vigilance; exaggerated startle response;
physiological reactivity ».
[7]. Mworoha 1987 et J.P. Chrétien
2000.
[8]. Renault & Daget, 1985.
[9]. La proportion entre ces différents
groupes est aujourd’hui estimée comme suit : les Twa 1%
de la population, des Hutu 84 % et les Tutsi 14%.
[10]. Harroy 1984 , Gahama 1983.
[11].Barancira, à paraître.
[12]. Collart 1981, Linden 1999.
[13]. Guichaoua 1997.
[14]. La Pradelle 2005.
[15]. Poulain 1998, Birabuza 1998.
[16]. J.P. Chrétien 1997 &
2000, Breackman 1994, Amselle & M’Bokolo 1999.
[17].Parmi lesquels Sylvestre Barancira
et Tobie Nathan.
[18]. Ces chiffres sont ceux de l’UNICEF
.
[19]. Il s’agit de Fr. Michael
Lapsley SSM, Directeur de « Institute of healing of memories ».
[20]. Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
adoptée et ouverte à la signature, à la ratification
et à l'adhésion par l'Assemblée générale
dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984.
[21]. Pour l’ensemble de la convention,
cf. http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_cat39_fr.htm.
[22]. Tobie Nathan, 2001.
[23]. J’ai choisi de présenter
ici un exemple de thérapie du traumatisme, il en existe bien
sur d’autres. Pour une expérience de formation et de soin
à l’opposé de ce type de démarche et qui
prend en compte les pratiques culturelles de la société
burundaise, cf. Lucien Hounkpatin, 2005.
[24]. « Akabonge, Intuntu, gutekegwa
n’ubwoba ; kuba muvyagutuntuje nkuko umengo bisubiye kugaruka
; Kwiyumanganya ivyibutso bituntuje ; Kuyinga ; kurandamuka, kuzanzamuka
; Kuravuta, ou indoto mbi ; Intezi ; Ibihe vy’ivyibutso bigoye
; Kudedemba ; Gushangashirwa bidasanzwe ; kuba umwehu wahora wiyumvira
neza ; Mahindagu, kuhindagurika; Kwihebura birenze urugero ; kuba utacihangana
mu bibabaje canke binezereza ; ubwoba burenze atampamvu, kugira ikinya
» cette traduction du tableau clinique du PTSD est de Verdiane
BUKUMI, que je remercie.
[25]. L’expertise du projet de
formation et de prise en charge de cette ONG installée au Burundi
a permis de montrer que « le sentiment d’injustice »
et « la spoliation des biens » constituent des définitions
de la torture rentenues par les bénéficiaires alors qu’elles
n’existent pas dans le tableau clinique proposé. Effectivement,
les deux plus grands drames pour la population rurale burundaise après
10 ans de crise sont la pauvreté et l’insalubrité
dans lesquelles elle est plongée ainsi que le sentiment de déshonneur
que cette situation engendre, sans entrevoir pour l’instant aucun
espoir d’amélioration réelle. Pour un compte rendu
de cette expertise, cf. www.sfcg.org/sfcg/evaluations/burundi.pdf.
|
|
| |
|
 Droits de diffusion et de reproduction réservés ©
2006— Centre Georges Devereux
Droits de diffusion et de reproduction réservés ©
2006— Centre Georges Devereux
|
 |