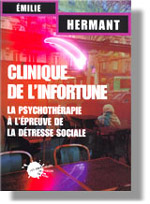|
De l’autre côté
du miroir.
« Sacks, vous êtes un cas ! »
Le chirurgien qui a opéré la jambe d’Oliver Sacks.
Emilie Hermant[1] |
|
Conférence prononcée le 13 octobre 2006 au colloque La
psychothérapie à l'épreuve de ses usagers. |
|
Les pratiques du savoir
|
|
|
 J’ai la mission d’introduire le dernier après-midi
du colloque… Je dois vous présenter le thème de
cette demi-journée, qui s’intitule « Le savoir
‘psy’ à l’épreuve des usagers ».
C’est une mission compliquée ! D’abord parce que
« Le savoir ‘psy’ » est un très vaste
sujet, ensuite parce que les intervenants de cet après midi,
s’ils vont en effet tous évoquer la question de la connaissance
en psychologie, vont le faire depuis des terrains et surtout des manières
d’aborder le problème extrêmement différents
les uns des autres — les Troubles Obsessionnels Compulsifs,
le traumatisme psychique des Hutus et des Tutsis, la géopolitique
clinique et pour finir, la thérapeutique Yoruba… Or s’il
y a quelque chose que je veux justement éviter, c’est
de sacrifier cette hétérogénéité
pour le bien de mon introduction ; il est hors de question que je
« fourre tout dans un seul et même sac ». Ce serait
un geste anticonstitutionnel vis à vis de l’ethnopsychiatrie
qui est défendue dans ce colloque. Ce serait ethnopsychiatriquement
incorrect, si vous voulez !
J’ai la mission d’introduire le dernier après-midi
du colloque… Je dois vous présenter le thème de
cette demi-journée, qui s’intitule « Le savoir
‘psy’ à l’épreuve des usagers ».
C’est une mission compliquée ! D’abord parce que
« Le savoir ‘psy’ » est un très vaste
sujet, ensuite parce que les intervenants de cet après midi,
s’ils vont en effet tous évoquer la question de la connaissance
en psychologie, vont le faire depuis des terrains et surtout des manières
d’aborder le problème extrêmement différents
les uns des autres — les Troubles Obsessionnels Compulsifs,
le traumatisme psychique des Hutus et des Tutsis, la géopolitique
clinique et pour finir, la thérapeutique Yoruba… Or s’il
y a quelque chose que je veux justement éviter, c’est
de sacrifier cette hétérogénéité
pour le bien de mon introduction ; il est hors de question que je
« fourre tout dans un seul et même sac ». Ce serait
un geste anticonstitutionnel vis à vis de l’ethnopsychiatrie
qui est défendue dans ce colloque. Ce serait ethnopsychiatriquement
incorrect, si vous voulez !
 Ce thème,
« Le savoir ‘psy’ », peut à première
vue apparaître excessivement théorique et abstrait —
un thème rêvé pour un épistémologue,
par exemple. Mais heureusement que les philosophes des sciences comme
Bruno Latour et Isabelle Stengers sont passés par là
et qu’il est possible de traiter de la connaissance scientifique
comme ce qu’elle est aussi, comme ce qu’elle est avant
tout : un ensemble de pratiques. Ce n’est pas au Centre Georges
Devereux que l’on va dire le contraire… La méthodologie
à l’œuvre dans chacune des consultations du Centre
a précisément été pensée comme
une pratique de la recherche. Que ce soit avec les familles migrantes
adressées par les juges des enfants ou avec les patients que
nous recevons dans le cadre de nos différents dispositifs de
recherche, l’obsession des intervenants du Centre Georges Devereux,
c’est de mettre à l’épreuve « le »
savoir-psy en le confrontant à d’autres savoirs, ceux
qui sont charriés par les mondes de nos patients. En d’autres
termes, il s’agit de s’intéresser au savoir psy,
non pas comme une entité abstraite, stabilisée, anonyme,
universelle et éternelle, mais au contraire comme un processus
très localisé, en mouvement, un processus de construction
par des collectifs. Comme Philippe Pignarre a rappelé tout
cela très précisément hier matin, je ne m’étendrai
pas. Ce thème,
« Le savoir ‘psy’ », peut à première
vue apparaître excessivement théorique et abstrait —
un thème rêvé pour un épistémologue,
par exemple. Mais heureusement que les philosophes des sciences comme
Bruno Latour et Isabelle Stengers sont passés par là
et qu’il est possible de traiter de la connaissance scientifique
comme ce qu’elle est aussi, comme ce qu’elle est avant
tout : un ensemble de pratiques. Ce n’est pas au Centre Georges
Devereux que l’on va dire le contraire… La méthodologie
à l’œuvre dans chacune des consultations du Centre
a précisément été pensée comme
une pratique de la recherche. Que ce soit avec les familles migrantes
adressées par les juges des enfants ou avec les patients que
nous recevons dans le cadre de nos différents dispositifs de
recherche, l’obsession des intervenants du Centre Georges Devereux,
c’est de mettre à l’épreuve « le »
savoir-psy en le confrontant à d’autres savoirs, ceux
qui sont charriés par les mondes de nos patients. En d’autres
termes, il s’agit de s’intéresser au savoir psy,
non pas comme une entité abstraite, stabilisée, anonyme,
universelle et éternelle, mais au contraire comme un processus
très localisé, en mouvement, un processus de construction
par des collectifs. Comme Philippe Pignarre a rappelé tout
cela très précisément hier matin, je ne m’étendrai
pas.
|
télécharger
au format word :


|
La jambe d’Oliver
|
|
|

Mais revenons à la pratique, ou plus exactement à l’approche
pragmatique du savoir psy. A ce sujet, et pour ajouter un peu plus
encore à l’irréductible hétérogénéité
de cette après midi, j’aimerais vous raconter —
pragmatisme oblige — une histoire, une histoire de cas, comme
on dit. Cette histoire a la particularité de faire symétrie
avec la conférence de Catherine Grandsard qui évoquait
hier matin son patient devenu thérapeute, puisqu’il s’agit
maintenant de raconter l’histoire d’un thérapeute
devenu patient. Cette histoire est racontée dans un livre d’Oliver
Sacks. Même s’il n’est peut être plus besoin
de présenter Oliver Sacks, illustre neuropsychologue d’origine
anglaise, qui vit depuis les années soixante à New York
où il exerce à la fois comme professeur de neurologie
et comme praticien, même s’il n’est peut être
plus besoin de présenter cet auteur dont les merveilleux livres
sont traduits dans 22 langues, c’est pourtant bien de son cas,
et non de l’un de ses cas, dont j’aimerais vous parler
maintenant. En 1984, il publie Sur une jambe, c’est son troisième
livre, après Migraine, qui était paru en 70 et Cinquante
ans de sommeil, paru en 73. Sur une jambe — Témoignage,
est moins connu que ses autres livres [2]
, et pourtant c’est peut être le plus intéressant
de tous. En tous cas, moi, je l’ai lu avec une passion toute
particulière, d’abord parce qu’il s’agit
d’une espèce d’« autobiographie neuropsychologique
», qu’il a écrit (et qui se lit) comme un vrai
roman. Ensuite parce que ce livre est une histoire de révélation.
L’expérience qu’il y raconte en même temps
que la façon dont il rapporte cette expérience font
révélation pour lui. Deux choses se transforment radicalement
pour Sacks à partir de l’écriture de ce livre
: son champ de recherche et sa façon d’écrire,
de transmettre son savoir ; en d’autres termes, sa très
particulière façon de savoir ce qu’il sait naît
pendant qu’il écrit ce livre — et s’il est
raisonnable de penser que ce processus a commencé bien avant
cette histoire, la naissance de ce genre de choses se faisant souvent
en plusieurs fois, ce livre marque véritablement une rupture
dans la bibliographie de Sacks : c’est après avoir écrit
Sur une jambe qu’il va trouver/savoir/s’autoriser/se permettre/être
désormais contraint… — les processus à l’œuvre
dans l’écriture des livres savants pourraient à
eux seuls faire l’objet d’un colloque supplémentaire…
— c’est après avoir écrit Sur une jambe,
donc, que Sacks va se mettre à écrire les livres si
singuliers qu’on lui connaît, de L’homme qui prenait
sa femme pour un chapeau qui paraît un an plus tard, en 1985,
à Un anthropologue sur Mars, qui paraît dix ans plus
tard, en 1995. |
 |
|
 L’histoire
est la suivante. Nous sommes au début des années quatre-vingt,
Sacks a tout juste cinquante ans, il est en pleine possession de
ses moyens physiques, « fort comme un buffle », comme
il le dit lui-même non sans malice, et c’est depuis
longtemps un médecin reconnu, quoi que parfois critiqué
pour l’originalité, la non orthodoxie de certains de
ses choix méthodologiques. Un matin d’été,
il part seul pour l’une de ces randonnées dont il raffole,
sur le flanc d’une montagne de Norvège où il
passe ses vacances. Alors qu’il a presque terminé l’ascension
du sentier abrupte qui le mène au sommet, il se retrouve
nez à nez avec un taureau — avec un monstre plus exactement,
un monstre norvégien, tout blanc, doté de cornes immenses
et d’horribles yeux globuleux dont la taille se met à
augmenter démesurément, occupant en quelques secondes
tout le champ de vision de Sacks… Sacks parvient à
garder son calme quelques instants, puis « ses nerfs lâchent
» et il part en trombe dans le sens inverse, c’est à
dire qu’il commence à dévaler, à survoler
même, le sentier qu’il avait mis quatre longues heures
à gravir. Presque aussitôt, il tombe et il se blesse
grièvement la jambe gauche, au niveau du genou et du muscle
de la cuisse. Il se traîne pendant des heures et des heures
pour tenter de gagner la vallée, dans des douleurs abominables
mais il ne progresse pas assez vite, et il serait certainement mort
des suites de sa blessure et du froid de la nuit s’il n’avait
pas été sauvé par des chasseurs en train de
bivouaquer non loin de là. La blessure est grave et notre
héros est transporté en urgence dans un hôpital
de Londres pour se faire opérer. Sa prise en charge, depuis
son transfert de Norvège jusqu’à l’opération
à Londres correspond à une expérience presque
aussi bouleversante que sa chute : de médecin, Sacks est
devenu patient. Ce dernier point n’a rien de très remarquable.
Qui, parmi les soignants qui se trouvent dans cette salle, n’a
jamais fait cette expérience certes pénible, mais
assez banale : être un patient ? Jusque là, l’aventure
de Sacks est certainement une expérience très marquante
— une expérience traumatique, dirions-nous… elle
est vraisemblablement un enseignement pour lui (ne plus jamais partir
seul en randonnée en Norvège, par exemple), mais elle
n’est pas encore tout à fait une révélation. L’histoire
est la suivante. Nous sommes au début des années quatre-vingt,
Sacks a tout juste cinquante ans, il est en pleine possession de
ses moyens physiques, « fort comme un buffle », comme
il le dit lui-même non sans malice, et c’est depuis
longtemps un médecin reconnu, quoi que parfois critiqué
pour l’originalité, la non orthodoxie de certains de
ses choix méthodologiques. Un matin d’été,
il part seul pour l’une de ces randonnées dont il raffole,
sur le flanc d’une montagne de Norvège où il
passe ses vacances. Alors qu’il a presque terminé l’ascension
du sentier abrupte qui le mène au sommet, il se retrouve
nez à nez avec un taureau — avec un monstre plus exactement,
un monstre norvégien, tout blanc, doté de cornes immenses
et d’horribles yeux globuleux dont la taille se met à
augmenter démesurément, occupant en quelques secondes
tout le champ de vision de Sacks… Sacks parvient à
garder son calme quelques instants, puis « ses nerfs lâchent
» et il part en trombe dans le sens inverse, c’est à
dire qu’il commence à dévaler, à survoler
même, le sentier qu’il avait mis quatre longues heures
à gravir. Presque aussitôt, il tombe et il se blesse
grièvement la jambe gauche, au niveau du genou et du muscle
de la cuisse. Il se traîne pendant des heures et des heures
pour tenter de gagner la vallée, dans des douleurs abominables
mais il ne progresse pas assez vite, et il serait certainement mort
des suites de sa blessure et du froid de la nuit s’il n’avait
pas été sauvé par des chasseurs en train de
bivouaquer non loin de là. La blessure est grave et notre
héros est transporté en urgence dans un hôpital
de Londres pour se faire opérer. Sa prise en charge, depuis
son transfert de Norvège jusqu’à l’opération
à Londres correspond à une expérience presque
aussi bouleversante que sa chute : de médecin, Sacks est
devenu patient. Ce dernier point n’a rien de très remarquable.
Qui, parmi les soignants qui se trouvent dans cette salle, n’a
jamais fait cette expérience certes pénible, mais
assez banale : être un patient ? Jusque là, l’aventure
de Sacks est certainement une expérience très marquante
— une expérience traumatique, dirions-nous… elle
est vraisemblablement un enseignement pour lui (ne plus jamais partir
seul en randonnée en Norvège, par exemple), mais elle
n’est pas encore tout à fait une révélation.
 Les complications
commencent les jours qui suivent l’opération —
qui a notamment consisté à réparer son genou
et à recoudre le tendon arraché de son muscle quadriceps.
Les jours passent et malgré la satisfaction de tous —
l’opération est un succès, le chirurgien est
très content — Sacks, lui, est très mal à
l’aise. Il ne sent pas sa jambe, elle n’a aucune présence,
elle n’a plus aucune réaction. Sous son plâtre,
le muscle est totalement atonique, il reste flasque, non pas exactement
comme s’il était mort, mais comme s’il était
une espèce de corps étranger qui ne serait pas un
muscle — qui serait le fantôme d’un muscle, peut
être ? Sacks sent qu’il y a là quelque chose
d’anormal, mais le chirurgien et les kinés qui s’occupent
de lui ne prennent pas ses plaintes au sérieux. Les jours,
les semaines passent et cette sensation, loin de diminuer, persiste
et plonge notre neuropsychologue dans un malaise croissant. Non
seulement sa jambe ne répond plus à ses efforts quotidiens,
même pas par un infime petit signe de jambe infirme, mais
des sensations de dé-réalisation très étranges
et effrayantes accompagnent cette espèce d’expérience
de trou dans son corps. Chaque nuit, il fait cauchemar sur cauchemar,
il rêve par exemple que c’est la guerre et qu’une
« bombe à déréalisation » sévit
autour de lui, produisant des trous dans la réalité,
détruisant la pensée, détruisant l’espace
même de la pensée. Souvent, il a l’impression
de devenir fou, d’ailleurs il ne peut rien dire de ses sensations
aux médecins qui le regardent sinon comme un fou, du moins
comme un hystérique quand il essaie d’expliquer ce
qui lui arrive : tout est normal, Monsieur Sacks, votre jambe est
réparée, vous devez faire de la rééducation,
voilà tout ! Mais lui sait très bien ce qu’il
sent et ce qu’il sent est extraordinairement effrayant : il
n’a plus de jambe gauche et il n’a plus aucune idée
d’où elle peut bien se trouver. Tout ce temps, bien
sûr, notre patient ne cesse jamais d’être un neuropsychologue
pour autant. Il écrit à Louriia, le célèbre
neurologue Russe, avec lequel il est en correspondance depuis quelques
années. Sacks lui raconte qu’il est persuadé
que pendant l’opération, son cerveau a été
atteint d’une manière ou d’une autre, ce qui
expliquerait la « neuropathie » [3]
dont souffre sa jambe, comparable à celle qu’il a constatée
chez des patients atteints par exemple de tumeur cérébrale.
La neurologie ne peut alors expliquer autrement ce genre de phénomène
: un dérèglement pareil a forcément une cause
au niveau central. Or son cerveau n’a subit aucun dommage,
ni pendant la chute, ni pendant l’opération. Vous voyez,
Sacks fait le détective, tout se passe comme Tobie Nathan
nous le disait hier : il est malade, il cherche l’être
qui est derrière tout ça, mais c’est triste,
c’est douloureux, il est seul — et malheureusement pour
lui, son ami Louriia est en vacances dans sa datcha d’été
et ne lira sa lettre que des semaines plus tard… Les complications
commencent les jours qui suivent l’opération —
qui a notamment consisté à réparer son genou
et à recoudre le tendon arraché de son muscle quadriceps.
Les jours passent et malgré la satisfaction de tous —
l’opération est un succès, le chirurgien est
très content — Sacks, lui, est très mal à
l’aise. Il ne sent pas sa jambe, elle n’a aucune présence,
elle n’a plus aucune réaction. Sous son plâtre,
le muscle est totalement atonique, il reste flasque, non pas exactement
comme s’il était mort, mais comme s’il était
une espèce de corps étranger qui ne serait pas un
muscle — qui serait le fantôme d’un muscle, peut
être ? Sacks sent qu’il y a là quelque chose
d’anormal, mais le chirurgien et les kinés qui s’occupent
de lui ne prennent pas ses plaintes au sérieux. Les jours,
les semaines passent et cette sensation, loin de diminuer, persiste
et plonge notre neuropsychologue dans un malaise croissant. Non
seulement sa jambe ne répond plus à ses efforts quotidiens,
même pas par un infime petit signe de jambe infirme, mais
des sensations de dé-réalisation très étranges
et effrayantes accompagnent cette espèce d’expérience
de trou dans son corps. Chaque nuit, il fait cauchemar sur cauchemar,
il rêve par exemple que c’est la guerre et qu’une
« bombe à déréalisation » sévit
autour de lui, produisant des trous dans la réalité,
détruisant la pensée, détruisant l’espace
même de la pensée. Souvent, il a l’impression
de devenir fou, d’ailleurs il ne peut rien dire de ses sensations
aux médecins qui le regardent sinon comme un fou, du moins
comme un hystérique quand il essaie d’expliquer ce
qui lui arrive : tout est normal, Monsieur Sacks, votre jambe est
réparée, vous devez faire de la rééducation,
voilà tout ! Mais lui sait très bien ce qu’il
sent et ce qu’il sent est extraordinairement effrayant : il
n’a plus de jambe gauche et il n’a plus aucune idée
d’où elle peut bien se trouver. Tout ce temps, bien
sûr, notre patient ne cesse jamais d’être un neuropsychologue
pour autant. Il écrit à Louriia, le célèbre
neurologue Russe, avec lequel il est en correspondance depuis quelques
années. Sacks lui raconte qu’il est persuadé
que pendant l’opération, son cerveau a été
atteint d’une manière ou d’une autre, ce qui
expliquerait la « neuropathie » [3]
dont souffre sa jambe, comparable à celle qu’il a constatée
chez des patients atteints par exemple de tumeur cérébrale.
La neurologie ne peut alors expliquer autrement ce genre de phénomène
: un dérèglement pareil a forcément une cause
au niveau central. Or son cerveau n’a subit aucun dommage,
ni pendant la chute, ni pendant l’opération. Vous voyez,
Sacks fait le détective, tout se passe comme Tobie Nathan
nous le disait hier : il est malade, il cherche l’être
qui est derrière tout ça, mais c’est triste,
c’est douloureux, il est seul — et malheureusement pour
lui, son ami Louriia est en vacances dans sa datcha d’été
et ne lira sa lettre que des semaines plus tard…
 Ses cauchemars
cessent au moment où on lui retire son plâtre et au
bout de trois ou quatre semaines d’absence totale au monde
en général, et au corps de Sacks en particulier, sa
jambe montre quelques premiers signes sporadiques de vie nerveuse,
sous la forme de frémissements, de spasmes incontrôlés,
parfois de douleurs foudroyantes. Pour la première fois,
il doit se lever et apprendre à marcher avec des béquilles.
Etant donné qu’il ne sent toujours pas sa jambe, cet
exercice est d’une difficulté inouïe : non seulement
il ne sait plus marcher, mais en plus, comme il n’a aucune
idée de l’emplacement où se trouve sa jambe,
il est empêché dans ce réapprentissage par la
farouche récalcitrance de son membre. Il écrit : «
Ce n’était pas ma perception en tant que telle qui
était chaotique, mais l’espace lui-même, ou la
mesure — ce qui précède la perception. J’eus
le sentiment, pendant même que je vivais cette expérience,
de contempler les fondements mêmes de la mesure, de la mensuration,
de la constitution d’un monde. »[4]
Autrement dit, la re-naissance de sa jambe n’est permise que
par la re-naissance du monde, par la fondation de toutes les coordonnées
d’un monde nouveau. Ses cauchemars
cessent au moment où on lui retire son plâtre et au
bout de trois ou quatre semaines d’absence totale au monde
en général, et au corps de Sacks en particulier, sa
jambe montre quelques premiers signes sporadiques de vie nerveuse,
sous la forme de frémissements, de spasmes incontrôlés,
parfois de douleurs foudroyantes. Pour la première fois,
il doit se lever et apprendre à marcher avec des béquilles.
Etant donné qu’il ne sent toujours pas sa jambe, cet
exercice est d’une difficulté inouïe : non seulement
il ne sait plus marcher, mais en plus, comme il n’a aucune
idée de l’emplacement où se trouve sa jambe,
il est empêché dans ce réapprentissage par la
farouche récalcitrance de son membre. Il écrit : «
Ce n’était pas ma perception en tant que telle qui
était chaotique, mais l’espace lui-même, ou la
mesure — ce qui précède la perception. J’eus
le sentiment, pendant même que je vivais cette expérience,
de contempler les fondements mêmes de la mesure, de la mensuration,
de la constitution d’un monde. »[4]
Autrement dit, la re-naissance de sa jambe n’est permise que
par la re-naissance du monde, par la fondation de toutes les coordonnées
d’un monde nouveau.
 Comme souvent avec
les histoires de maladies, l’expérience-révélation
de Sacks se poursuit et trouve une apogée particulière
lors de sa guérison. Tant qu’il essaie simplement de
réapprendre à marcher, il n’y arrive pas, et
il se trouve projeté dans des abîmes morales sans fond,
se voyant non seulement condamné à vie dans une chaise
roulante, mais rendu fou par la coexistence d’un membre dont
tout le monde dit qu’il est normal, certes un peu maigre mais
bien vivant, alors que lui sent que cette chose aussi inerte, aussi
froide qu’un cadavre ne lui appartient en aucune façon.
Il cite Nietzsche à la rescousse pour exprimer la terrible
crise qu’il traverse alors : « Si vous scrutez l’abîme,
il vous scrutera en retour »… Tout bascule le jour où,
essayant une énième fois de réapprendre à
marcher, traversé par les terribles sensations kinesthésiques
hallucinatoires que j’ai citées plus haut, qu’il
décrit comme une sorte de big bang intime, un mélange
de frayeur et d’expérience mystique, il est sauvé
par la musique — et plus exactement par un passage fortissimo
du concerto pour violon de Mendelssohn. Au plus fort de son désespoir,
alors qu’il tient debout tant bien que mal entre le mur de
l’hôpital et le bras de sa kiné, la musique de
Mendelssohn monte en lui et lui impulse, lui substitue son propre
mouvement. Il écrit : « Aussitôt, sans que j’y
aie préalablement pensé, sans que je l’aie aucunement
projeté, je me mis à marcher, sans effort, joyeusement,
avec la musique »[5] . Les
retrouvailles avec sa jambe perdue ont des accents William-Jamessiens
: « J’étais dans le couloir, en train de revenir
vers ma chambre, lorsque se produisit ce miracle — ma musique,
la marche, l’actuation de ma jambe, tout en même temps.
Désormais, j’en eus la certitude absolue, je pouvais
croire en ma jambe, je savais, de nouveau, marcher. »[6]
Il conçoit aussitôt une espèce de paradigme
personnel de la marche. Pour lui, à ce moment-là,
« La musique, l’action et la réalité ne
font qu’un. »[7] . A
partir de cet instant, il va progressivement remarcher, jusqu’à
sa guérison totale, qui prendra quelques semaines. Comme souvent avec
les histoires de maladies, l’expérience-révélation
de Sacks se poursuit et trouve une apogée particulière
lors de sa guérison. Tant qu’il essaie simplement de
réapprendre à marcher, il n’y arrive pas, et
il se trouve projeté dans des abîmes morales sans fond,
se voyant non seulement condamné à vie dans une chaise
roulante, mais rendu fou par la coexistence d’un membre dont
tout le monde dit qu’il est normal, certes un peu maigre mais
bien vivant, alors que lui sent que cette chose aussi inerte, aussi
froide qu’un cadavre ne lui appartient en aucune façon.
Il cite Nietzsche à la rescousse pour exprimer la terrible
crise qu’il traverse alors : « Si vous scrutez l’abîme,
il vous scrutera en retour »… Tout bascule le jour où,
essayant une énième fois de réapprendre à
marcher, traversé par les terribles sensations kinesthésiques
hallucinatoires que j’ai citées plus haut, qu’il
décrit comme une sorte de big bang intime, un mélange
de frayeur et d’expérience mystique, il est sauvé
par la musique — et plus exactement par un passage fortissimo
du concerto pour violon de Mendelssohn. Au plus fort de son désespoir,
alors qu’il tient debout tant bien que mal entre le mur de
l’hôpital et le bras de sa kiné, la musique de
Mendelssohn monte en lui et lui impulse, lui substitue son propre
mouvement. Il écrit : « Aussitôt, sans que j’y
aie préalablement pensé, sans que je l’aie aucunement
projeté, je me mis à marcher, sans effort, joyeusement,
avec la musique »[5] . Les
retrouvailles avec sa jambe perdue ont des accents William-Jamessiens
: « J’étais dans le couloir, en train de revenir
vers ma chambre, lorsque se produisit ce miracle — ma musique,
la marche, l’actuation de ma jambe, tout en même temps.
Désormais, j’en eus la certitude absolue, je pouvais
croire en ma jambe, je savais, de nouveau, marcher. »[6]
Il conçoit aussitôt une espèce de paradigme
personnel de la marche. Pour lui, à ce moment-là,
« La musique, l’action et la réalité ne
font qu’un. »[7] . A
partir de cet instant, il va progressivement remarcher, jusqu’à
sa guérison totale, qui prendra quelques semaines.
|
|
La maladie est une
contrainte à produire de la pensée supplémentaire |
|
|

Cette maladie a contraint Sacks à produire de la pensée.
Non pas seulement parce qu’il était Sacks, non pas seulement
parce qu’il était un professionnel de la pensée,
mais justement parce qu’il était un patient. La maladie,
par sa nature même d’expérience à la fois
si douloureuse et si étrange, par son caractère nécessairement
incompréhensible pour celui qui en est affecté, est
une contrainte à produire non seulement de la pensée
supplémentaire, mais aussi, de la pensée qui soit à
la hauteur. Cette expérience et cette nécessité
de la pensée consubstantielle à la maladie, elle est
là chez tous les malades. La maladie, quand elle est un peu
plus grave qu’une grippe cependant (et encore…), qu’elle
soit mentale ou physique, pose une énigme farouchement personnelle
au malade : pourquoi cela m’arrive t-il : pour quoi faire ?
 A quoi sert cette
production de pensée qui surgit au contact de l’expérience-maladie
? A calmer les angoisses du patient ? A donner du sens, comme on dit
parfois un peu trop rapidement en psycho ? Je ne crois pas ; en tous
cas, cette fois, avec Sacks, ce supplément de pensée
l’entraîne beaucoup plus loin que le fait de simplement
« donner du sens ». Sacks n’a pas seulement produit
de la pensée pour lui, il n’a pas seulement écrit
un livre à partir de cette histoire, il a produit de la connaissance,
du savoir supplémentaire pour sa discipline, la neuropsychologie.
Certes, Sacks n’a pas été un patient comme les
autres — si tant est qu’il y ait des patients comme les
autres… Il a traversé une expérience relevant
d’ailleurs d’un genre auquel l’ethnopsychiatrie
s’est toujours vivement intéressée : il a été
un thérapeute-malade et ce faisant, il est devenu à
la fois plus thérapeute et plus savant qu’avant. Là,
tandis qu’il faisait ce voyage effrayant, là et nulle
part ailleurs, il a découvert sa très particulière
manière d’être Oliver Sacks : un médecin
qui s’intéresse aux malades non pas depuis leurs handicaps,
mais au contraire parce qu’ils ont des compétences que
les autres n’ont pas et parce qu’ils révèlent
des aspects du monde que les autres ne sont pas capables de voir.
 Sacks écrit,
à propos du moment où il recouvre la marche dans le
couloir de l’hôpital : « Je venais de vivre les
dix minutes les plus mémorables et les plus capitales de toute
ma vie. » [8]
Que contiennent ces dix minutes ? Un chaînon manquant. Un bloc
condensé de connaissances, un amalgame d’amorces de savoir
sur ce qu’il a appelé par la suite, avec Louriia, les
« neuropathies périphériques », mais aussi,
et étroitement mêlés à cette espèce
d’eureka scientifique, une expérience très étrange,
presque mystique — Sacks parle de grâce. Il écrit
: « Une grâce entra, comme entre la grâce, au cœur
même des choses, dans le centre le plus secret, le plus profond
et le plus inaccessible de l’être, et elle coordonna,
subordonna instantanément tous les phénomènes
à elle-même. Elle rendit le mouvement suivant évident,
certain, naturel. La grâce s’avérait la condition
préalable et l’essence de tout acte. Solvitur ambulando
: la solution au problème de la marche est… la marche.
La seule façon d’y parvenir est… d’y parvenir.
La clé de ce paradoxe est le mystère de la grâce.
L’action et la pensée trouvèrent là leur
terme et leur repos. » [9] |
 |
|
 Sacks raconte qu’il
n’a plus jamais pu se laisser enfermer dans aucun «
catéchisme neurologique » après cette expérience.
Cet événement devient le fil conducteur de ses recherches
ultérieures. Après des travaux sur la migraine (il
était migraineux lui-même, il faut le noter en passant
!), le parkinsonisme, les symptômes postencéphalitiques,
le syndrome de Gilles de la Tourette, il se consacre désormais
aux perturbations de l’image corporelle consécutives
à des névropathies périphériques, et
rencontre alors des centaines de patients qui se plaignent de symptômes
similaires à ceux qu’il a lui-même subis après
son accident en montagne. Il fait alors les découvertes qu’il
consignera dans ses livres postérieurs à propos de
l’image et du soi corporels. Ces découvertes, aurait-il
pu les faire avant sa chute, avant son expérience de patient
? D’après les dires de Sacks lui-même, il est
probable que non. Sacks raconte qu’il
n’a plus jamais pu se laisser enfermer dans aucun «
catéchisme neurologique » après cette expérience.
Cet événement devient le fil conducteur de ses recherches
ultérieures. Après des travaux sur la migraine (il
était migraineux lui-même, il faut le noter en passant
!), le parkinsonisme, les symptômes postencéphalitiques,
le syndrome de Gilles de la Tourette, il se consacre désormais
aux perturbations de l’image corporelle consécutives
à des névropathies périphériques, et
rencontre alors des centaines de patients qui se plaignent de symptômes
similaires à ceux qu’il a lui-même subis après
son accident en montagne. Il fait alors les découvertes qu’il
consignera dans ses livres postérieurs à propos de
l’image et du soi corporels. Ces découvertes, aurait-il
pu les faire avant sa chute, avant son expérience de patient
? D’après les dires de Sacks lui-même, il est
probable que non.
 Ce que Sacks a
découvert au moment de son expérience de malade lui
a permis de voir/éprouver/apprendre/découvrir ce qui
était jusqu’à lors invisible aux médecins.
Ce n’est qu’à partir de cette connaissance si
particulièrement acquise qu’il a pu entendre ce que
les autres patients avaient à dire sur ce genre de phénomène.
Sans cela, il était dans le « catéchisme neurologique
», c’est à dire un peu dans la même surdité
que son chirurgien de Londres, qui, lorsque Sacks s’était
plaint, lui avait répondu en quelque sorte : « je ne
peux pas entendre ce que vous dîtes parce que je ne sais pas
de quoi vous voulez parler ». Cette affaire n’a pas
seulement à voir avec la capacité d’écoute
du soignant, ni avec son empathie, ni avec son intelligence, ni
avec son talent, mais avec ce principe fondamental suivant lequel,
en médecine comme en thérapie, les énoncés
des patients n’émergent que s’ils sont susceptibles
d’être véritablement entendus par leurs thérapeutes,
c’est à dire s’ils peuvent être re-connus
par eux : s’ils forment du « déjà connu
» pour le praticien. Sinon ces énoncés se taisent,
et alors ils sont autant de trous pour la connaissance de la maladie
dont souffre le patient. Le plus souvent, ces pensées —
en tant que telles, en tant qu’elles ne forment surtout pas
uniquement du matériel psychique à interpréter
mais bien des éléments à prendre en compte
dans le corpus même qui forme le savoir médical et
psychologique — n’intéressent ni la médecine,
ni la psychologie. Les patients gardent leurs sensations, leurs
découvertes pour eux et c’est autant de déperdition
fatale pour la connaissance médicale et psy. Ce que Sacks a
découvert au moment de son expérience de malade lui
a permis de voir/éprouver/apprendre/découvrir ce qui
était jusqu’à lors invisible aux médecins.
Ce n’est qu’à partir de cette connaissance si
particulièrement acquise qu’il a pu entendre ce que
les autres patients avaient à dire sur ce genre de phénomène.
Sans cela, il était dans le « catéchisme neurologique
», c’est à dire un peu dans la même surdité
que son chirurgien de Londres, qui, lorsque Sacks s’était
plaint, lui avait répondu en quelque sorte : « je ne
peux pas entendre ce que vous dîtes parce que je ne sais pas
de quoi vous voulez parler ». Cette affaire n’a pas
seulement à voir avec la capacité d’écoute
du soignant, ni avec son empathie, ni avec son intelligence, ni
avec son talent, mais avec ce principe fondamental suivant lequel,
en médecine comme en thérapie, les énoncés
des patients n’émergent que s’ils sont susceptibles
d’être véritablement entendus par leurs thérapeutes,
c’est à dire s’ils peuvent être re-connus
par eux : s’ils forment du « déjà connu
» pour le praticien. Sinon ces énoncés se taisent,
et alors ils sont autant de trous pour la connaissance de la maladie
dont souffre le patient. Le plus souvent, ces pensées —
en tant que telles, en tant qu’elles ne forment surtout pas
uniquement du matériel psychique à interpréter
mais bien des éléments à prendre en compte
dans le corpus même qui forme le savoir médical et
psychologique — n’intéressent ni la médecine,
ni la psychologie. Les patients gardent leurs sensations, leurs
découvertes pour eux et c’est autant de déperdition
fatale pour la connaissance médicale et psy.
 J’ai souhaité
vous raconter cette histoire parce qu’elle rappelle une évidence
pourtant constamment redoutée et évitée en
psychologie. Les chemins qui mènent au savoir déterminent
le savoir proprement dit. Ces chemins, ces voies, ces parcours de
connaissance, sont d’abord subjectifs, si par subjectif on
n’entend pas seulement l’expression d’un ego isolé
retranché dans son fort psychique intérieur, mais
aussi et surtout les contraintes internes et externes, la somme
des enjeux, personnels, sociaux, politiques, les alliances, qui
forment les attachements d’une personne et qui forment dans
le même mouvement ce qu’Isabelle Stengers appelle sa
capacité de récalcitrance. Quand nous évoquons
la question du savoir psy, je crois qu’il ne faut pas oublier
ce problème : cette subjectivité (mais le mot ne convient
pas, il est trop petit pour contenir tout ce je veux y mettre, il
faudrait en inventer un autre ? Nousjectif, par exemple ?) —
le problème, donc, c’est que tout ce qui constitue
cette « nousjectivité » est précisément
rejeté par la psychologie comme autant de biais méthodologiques. J’ai souhaité
vous raconter cette histoire parce qu’elle rappelle une évidence
pourtant constamment redoutée et évitée en
psychologie. Les chemins qui mènent au savoir déterminent
le savoir proprement dit. Ces chemins, ces voies, ces parcours de
connaissance, sont d’abord subjectifs, si par subjectif on
n’entend pas seulement l’expression d’un ego isolé
retranché dans son fort psychique intérieur, mais
aussi et surtout les contraintes internes et externes, la somme
des enjeux, personnels, sociaux, politiques, les alliances, qui
forment les attachements d’une personne et qui forment dans
le même mouvement ce qu’Isabelle Stengers appelle sa
capacité de récalcitrance. Quand nous évoquons
la question du savoir psy, je crois qu’il ne faut pas oublier
ce problème : cette subjectivité (mais le mot ne convient
pas, il est trop petit pour contenir tout ce je veux y mettre, il
faudrait en inventer un autre ? Nousjectif, par exemple ?) —
le problème, donc, c’est que tout ce qui constitue
cette « nousjectivité » est précisément
rejeté par la psychologie comme autant de biais méthodologiques.
 Cet après-midi,
il va être question d’expériences et de contextes
où cette capacité de récalcitrance est délibérément
placée au premier plan, en tant que donnée incontournable,
en tant que contrainte absolue pour le savoir en constitution, et
même souvent comme point de départ pour la connaissance
en train de se faire. Là où la psychologie voit habituellement
un biais méthodologique, là où elle s’écrie,
indignée/paniquée : stop ! interdit d’entrer
!, les intervenants de cet après-midi, à l’instar
de Sacks, nous proposent au contraire : je vous en prie, si vous
voulez qu’on fabrique du savoir, c’est par ici qu’il
faut passer… Cet après-midi,
il va être question d’expériences et de contextes
où cette capacité de récalcitrance est délibérément
placée au premier plan, en tant que donnée incontournable,
en tant que contrainte absolue pour le savoir en constitution, et
même souvent comme point de départ pour la connaissance
en train de se faire. Là où la psychologie voit habituellement
un biais méthodologique, là où elle s’écrie,
indignée/paniquée : stop ! interdit d’entrer
!, les intervenants de cet après-midi, à l’instar
de Sacks, nous proposent au contraire : je vous en prie, si vous
voulez qu’on fabrique du savoir, c’est par ici qu’il
faut passer…
 L’un des
modèles suprêmes de ce processus sera évoqué
en fin d’après-midi par Tobie Nathan et Lucien Hounkpatin
à propos d’une pratique thérapeutique qui se
déroule sous les yeux, sous la surveillance, du groupe qu’elle
concerne, les Yorubas du Bénin. Mais avant cela, nous allons
aborder une expérience menée un peu moins loin, conjointement
par Elie Hantouche, psychiatre, et l’Association Française
des personnes souffrant de Troubles Obsessionnels Compulsifs, représentée
par Christophe Demonfaucon, son Président, où un expert
travaille sous l’étroite et très rigoureuse,
quoi que très sympathique, surveillance d’un groupe
d’usagers. L’un des
modèles suprêmes de ce processus sera évoqué
en fin d’après-midi par Tobie Nathan et Lucien Hounkpatin
à propos d’une pratique thérapeutique qui se
déroule sous les yeux, sous la surveillance, du groupe qu’elle
concerne, les Yorubas du Bénin. Mais avant cela, nous allons
aborder une expérience menée un peu moins loin, conjointement
par Elie Hantouche, psychiatre, et l’Association Française
des personnes souffrant de Troubles Obsessionnels Compulsifs, représentée
par Christophe Demonfaucon, son Président, où un expert
travaille sous l’étroite et très rigoureuse,
quoi que très sympathique, surveillance d’un groupe
d’usagers.
|
|
Notes
|
|
|
[1]. Psychologue clinicienne
au Centre Georges Devereux (Université Paris 8). Intervention
pour le colloque d’ethnopsychiatrie « La psychothérapie
à l’épreuve de ses usagers », le 13 octobre
2006 à 14h30 dans le cadre de l’après-midi : «
Le savoir ‘psy’ à l’épreuve des usagers
».
[2]. Ma reconnaissance éternelle
à Vincent Bergerat pour avoir si bien compris ce que j’avais
tant de mal à faire, qu’il m’a fait découvrir
ce livre.
[3]. Le terme de neuropathie regroupe
toutes les affections du système nerveux périphérique,
formé de nerfs et de ganglions, par opposition aux encéphalopathies
(affections de l’encéphale) et aux myélopathis
(affections de la moelle épinière).
[4]. Oliver Sacks, p. 117.
[5]. Op. cit., p. 120, c’est
l’auteur qui souligne.
[6]. Op. cit., p. 120, c’est
l’auteur qui souligne.
[7]. Op. cit., p. 122.
[8]. Op. cit., p. 126.
[9]. Op. cit., p. 125-126.
|
|
Bibliographie |
|
|
|

William James, La volonté de croire, Les empêcheurs de
penser en rond, Paris, 2005.
 Catherine Lutz, La
dépression est-elle universelle ?, Les empêcheurs de
penser en rond, Paris, 2004.
 Bruno Latour, La
science en action — introduction à la sociologie des
sciences, Folio-Essai, Gallimard, Paris, 1995.
 Tobie Nathan, «
Manifeste pour une psychopathologie enfin scientifique », in
Médecins et sorciers, avec Isabelle Stengers, Les empêcheurs
de penser en rond, Paris, 1995.
 Oliver Sacks, Sur
une jambe — témoignage, Le Seuil, Paris, 1987. [Edition
originale : A leg to stand on, Gerald Ducworth & Co. Ltd., Londres
et Summit Books, New york, 1984.]
 Isabelle Stengers
et Bernadette Bensaude-Vincent, 100 mots pour commencer à penser
les sciences, Les empêcheurs de penser en rond, Paris, 2003. |
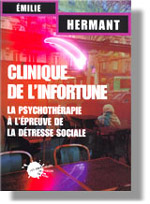
Clinique de l'infortune
La psychothérapie à l'épreuve
de la détresse sociale
Editions Le Seuil/Les Empêcheurs
de penser en rond, Paris, mai 2004 — 200 pages, 18 euros dans
les bonnes librairies
|
|
|
|
 Droits de diffusion et de reproduction réservés ©
2006— Centre Georges Devereux
Droits de diffusion et de reproduction réservés ©
2006— Centre Georges Devereux
|
 |